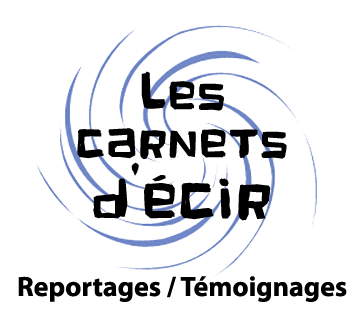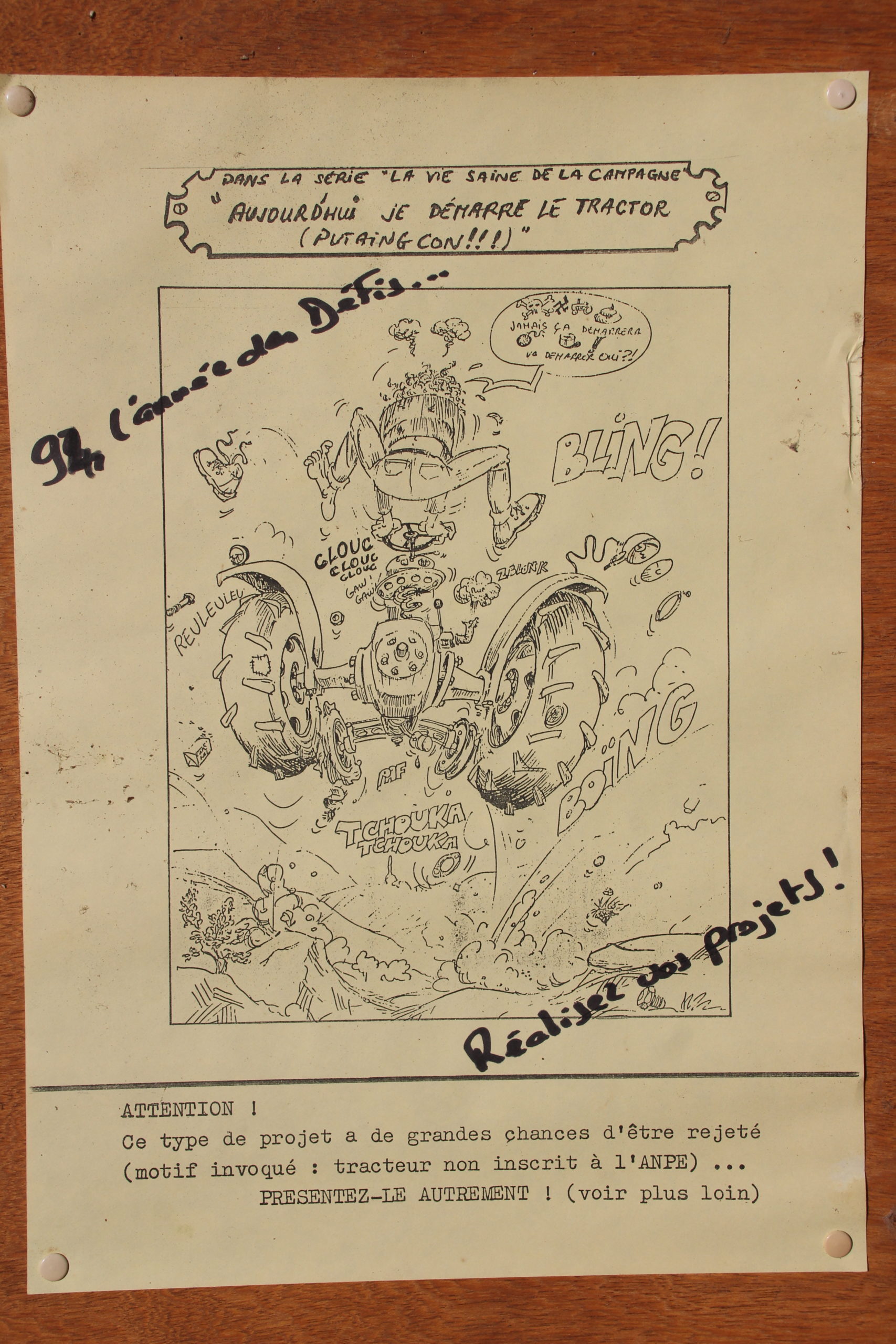Etienne et Mimi : une saga ardéchoise
Parce que " c'est quoi un bonheur de solitaire ? "
Il fait décidément très chaud sur cette terrasse qui surplombe un charmant vallon où serpente un petit rû qui rejoint Largentière un peu plus bas. Le mois de Janvier le plus chaud de l’histoire parait-il…
Et d’histoire, il en fût aussi question, hier soir, lors du dîner où nous avons partagé patates et fromage fondu, dans ce que nous ont raconté nos hôtes : Etienne et Michèle, que tout le monde semble appeler Mimi. Dans la soixantaine tous les deux. Je l’écoute, lui, maintenant, depuis un bon moment, cet hyperactif qui m’a dûment prévenu qu’il avait du mal à rester assis plus d’une heure de rang. Devant un bon café. Comme hier soir devant un bon verre de vin. Où il a commencé à me raconter un peu de son parcours.
Etienne Frommelt, président !?
Qu’est ce que j’ai commencé à en retenir ? A me rappeler hier soir avant de m’endormir au fond d’un lit préparé par les bons soins de Mimi, avec ce qu’il faut de couvertures ? Parce que les nuits sont fraîches dans la vallée. Et il a beau faire chaud dans la journée, ça ne change rien à cette règle météorologique liée à ce coin des contreforts cévenols depuis la nuit des temps : les nuits sont fraiches et puis c’est tout… Mais ce matin, à quel moment je me dis : « Mais ce type devrait postuler à la présidence du MEDEF ! » ? Je me garde bien de lui dire évidemment. D’abord parce que notre bonhomme a, toute sa vie, fuit avec constance toute forme de reconnaissance officielle et parce qu’ensuite, le Medef aussi sans doute… Bien sûr…
On the road…
Mais quand même, si le verbiage entrepreneurial autour du self made man n’est pas complètement un mythe, qui mieux que notre homme pourrait prétendre l’incarner ? Voilà quand même un type qui part de chez lui, il y a maintenait cinquante ans, pas encore majeur, sans autre héritage que sa tente et sa guitare, qui traverse la France, vient s’installer sur les crêtes du Vivarais et qui, de là, va se créer un monde, et même plusieurs, une famille, et même plusieurs, restaurer un nombre incalculable de maisons, bâtir encore de ses mains et de sa seule volonté deux entreprises associatives qui feront toutes deux florès. Et qui perdurent, toujours bel et bien là aujourd’hui. A s’occuper des laissés pour compte et accidentés de la vie ou tout bonnement aventuriers, amoureux des chemins de traverse. D’abord à travers une sorte d’ancêtre des missions locales, mais à vocation plus universelle et répondant au doux nom d’AMESUD, acronyme pour Association Montagne Emploi Sud. Et puis une autre d’accueil et d’accompagnement au domicile de personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes, handicapées, personnes âgées, malades convalescents pour qui il n’existait rien – ou pas grand chose – à l’époque, toujours là elle aussi, et qui s’appelle FAMIDAC.
Du côté de la ferme.... d'hier à aujourd'hui...
Deux initiatives distinctes qui vont l’occuper à plein régime trois décennies durant. Et qui ont en commun d’avoir eu pour siège social le propre domicile d’Etienne et Mimi, ce qui fut une ferme, où nous nous trouvons donc présentement, datant de 1772, située au dessus du bourg de Rocles, le long d’une route qui serpente entre coteaux peuplés de chênes et de châtaigniers ainsi que d’impavides villages perchés au bout d’engageants chemins sans autre issue d’eux mêmes.
Hier soir, me voilà donc, cherchant le sommeil, à imaginer ce qu’a pu bien être la vie d’Etienne. J’ai du m’endormir avec le garde-boue d’une Honda 125 en ligne de mire quelque part sur le route reliant les collines alsaciennes aux Cévennes. Et n’ai pas rêvé de syndicat patronal, c’est déjà ça. De toute façon, c’est mieux quand c’est Etienne qui la raconte, cette vie d’éclaireur. Vous allez voir qu’il y a beaucoup de cela.
Mais le matin venu, il n’est pas question de commencer une vraie discussion sur le sujet sans avoir fait le tour du propriétaire. Etienne y tient. Parce qu’il faut qu’il se dégourdisse les jambes : « il faut toujours que je fasse quelque chose. C’est comme ça depuis toujours ». Au vu de ce qu’il nous a été préalablement dit à son sujet – et notamment par les époux Barras de la scop Ardelaine et du viel audon qui en connaissent donc assurément un rayon en suractivité – et de ce que Michéle nous a suggéré hier soir, on veut bien le croire sans sourciller.
Dans les pas d’Etienne, en son royaume…
On le suit et on l’écoute bien volontiers nous raconter sa terre à lui dés le café avalé, à la lumière rasante du matin, filtrée par les épais feuillages, à dévaler vers le rû qui marque la limite de la propriété, des centaines de mètres en contrebas. Où nous rencontrons la famille de lamas – « c’est bien mieux que des chèvres parce qu’ils ne mangent pas tout sur leur passage mais font mourir les ronces à force de n’en manger que les feuilles » -, qui sont des bêtes curieuses accourant saluer le visiteur ; la cabane, dite la grangette, aménagée en gîte pour qui veut, tout comme la roulotte ayant appartenu à un groupe de saltimbanques qui faisait le tour des petits villages des monts d’Ardèche en proposant des spectacles et bals folk de ci de là. Le coin est encore rempli de rêveurs de cet acabit. A se demander si mai 68 n’a pas été finalement un concept inventé par l’office de tourisme ardéchois pour attirer tous les doux illuminés de par le monde sur ses plateaux granitiques.

Aux environs...
Imaginons donc : le départ de l’Alsace natale, ballon de Guebwiller derrière soi, dans la dix-septième année, juchée sur un vélo comme d’autre sur Rossinante, un sac à dos, la guitare, deux sacoches de chaque côté de la roue arrière. Et on quitte ce pays où le lycée ne veut plus de ce drôle de bonhomme qui vient juste d’avoir été un des animateurs d’un mouvement de protestation contre un projet de réforme visant à abroger les sursis militaires pour les étudiants de plus de vingt et un ans. Et à vrai dire, lui non plus n’en veut plus de l’institution scolaire, de ses horaires, de son temps contraint et « rester le cul sur une chaise pendant des heures, je n’en peux plus ». On est au début des années soixante-dix, deux mois avant le bachot qu’il ne passera jamais. Il part travailler à Bâle en alternance, un mois en intérim, un mois de découverte du vaste monde car il a horreur de cette Alsace surpeuplée, trop industrialisée et nucléarisée à son goût. Le temps d’amasser un petit pécule qui lui permet d’acheter une moto, une rutilante Honda 125 donc, le même modèle qu’utilisent les facteurs, qui l’amène d’abord jusqu’à Honfleur : « parce qu’on m’a dit que c’est joli ». Et puis, notre homme se rappelle un camp d’éclaireurs qu’il a fait quelques années plus tôt du côté de Naussac, dans le Haut Allier, aux confins de la Lozère, de l’Ardèche et de la Haute Loire : « Ça m’avait plu ». Voilà. « Mais ça caille trop au mois de mai. Il gelait encore sous la tente ». Du coup, il reprend la route et veut descendre jusqu’à Aubenas et son climat plus accueillant. Mais à mi chemin, du côté du col de la Chavade, dans la légendaire « côte de Mayres », il tombe sur un couple de babas cool comme il en essaime un peu partout dans le coin qui lui propose de dormir dans une grange du côté de Barnas.

Façade sud...L'escalier...
Le propriétaire est kiné à Vals dans la station thermale et sa femme élève des chèvres, comme il se doit. Le couple l’héberge un moment, il leur installe un robinet d’eau courante dans la cuisine qui, jusqu’alors, en était dépourvu. Et cet échange de bons procédés n’est pas seulement un détail pittoresque, comme vous allez le comprendre. Et ce sont encore eux qui lui indique une autre grange à vendre et à restaurer pas loin, près de Lentillères. Etienne va voir le propriétaire qui en veut 35000 francs ( vous savez, avant l’euro !?). Le problème est que notre homme n’est pas encore majeur et qu’il n’a bien évidemment pas le sou vaillant. Qu’à cela ne tienne, on se tope quand même la main et on se donne rendez-vous dans un an.
En haut, en bas…
Etienne enfourche donc derechef Rossinante et retourne fissa en Suisse. Où il va travailler pour une boite qui installe des panneaux de signalisation sur les autoroutes. Et dés qu’il a atteint l’âge de dix huit ans, il peut acheter la maison et commence alors la valse des aller-retours entre la Suisse et l’Ardèche pour retaper en bas la grange dés qu’il a gagné trois sous en haut. Les allers-retours durent ainsi trois années. La moto a désormais laissé la place à une bonne vieille Ami 6. Pour traîner les outils et aussi parce qu’entre temps, Etienne a rencontré celle qui devient sa compagne et avec qui il a un enfant. Il faut donc impérativement et au plus vite un toit solide pour la petite famille. Mais les débuts dans la maçonnerie sont loin d’aller de soi : « je ne sais rien faire, même pas gâcher du ciment. Et en plus à l’époque, on n’a pas de notice sur les sacs. Faut se débrouiller. Alors je fais des essais. Pour la charpente, c’est un voisin qui m’explique comment dégauchir un toit. Je découvre tout. »
Le syndrome du robinet.
Et quand le gîte a fini par être plus ou moins assuré, il faut bien penser à vivre. Et d’abord trouver un métier sur place. C’est là qu’Etienne se rappelle l’épisode du robinet dont l’absence compliquait la vie quotidienne chez le kiné avant son intervention. « Et donc là, je décide de faire le tour du village. Et des besoins des habitants. C’est ici un outil cassé, là un radiateur qui ne chauffe plus, ailleurs un lavabo arraché du mur, plus loin de l’électricité défectueuse ». Et son inventaire des besoins sous le coude, le voilà qui enfourche l’Ami 6 et remonte à Mulhouse, direction le centre AFPA local, où il annonce à la personne qui le reçoit, un rien médusée sans doute, qu’il veut apprendre à maçonner, forger, souder et réparer de l’électricité. La personne lui fait aimablement remarquer qu’il s’agit de quatre métiers différents (!) mais que la formation la plus généraliste qu’il propose est celle de plombier chauffagiste en dix mois. « Là, mon père décide de m’aider financièrement pour que je fasse la formation ».
Tant et si bien qu’ un beau jour, notre bonhomme, dûment diplômé, se retrouve à arpenter les routes d’Ardèche avec une estafette et à son compte. Très vite, il fait un peu de tout : plomberie, zinguerie, couverture, électricité, pose de carrelage…. Et cela ne satisfait guère notre artisan : « Je fais ça pendant trois ans à peu près. Et je me retrouve vite un peu comme un percepteur. A faire payer cher des prestations qui pourrait coûter bien moins. J’ai un peu l’impression d’être un escroc ».
Il arrête donc l’artisanat et se déclare comme salarié auprès de particuliers qui ont besoin d’un maître d’œuvre pour restaurer leurs résidences secondaires. Le coin en est plein. « Là, il me fallait gagner une relation de confiance. C’est pour ça que j’allais choisir les matériaux avec les clients et qu’ils ne payaient que ma prestation. Ca coûtait deux fois moins cher. Et moi, j’étais salarié. Avec une meilleure couverture sociale. J’ai fait ça pendant sept ans. J’ai bien dû restaurer de mes mains pas loin de cinquante maisons. Mais j’ai fini par me péter le dos. A trente ans. Je me suis retrouvé en invalidité et la sécu m’a demandé de changer de métier. Ma femme est partie. Je n’avais plus de boulot et deux enfants à charge ».

Largentière.
C’est là qu’Etienne devient formateur en GRETA et intervient sur des stages en métiers du bâtiment. Ca dure quelques mois. C’est là aussi qu’il entend parler d’une ferme avec son terrain et sa grange à vendre au dessus de Largentière. L’endroit lui plaît tout de suite. Le propriétaire n’en veut pas très cher, autour des deux cent cinquante mille francs ( l’équivalent de 40000 de nos euros), mais c’est vraiment une ruine, abandonnée depuis la guerre, avec son terrain de sept hectares de mauvaises ronces. Tout est à faire. Même le toit.
Et c’est bien ce que fait Etienne, avec un dos en compote, dormant dans une vieille camionnette, les enfants sous une tente. Il achète au mois de mai 1986 et « il faut absolument un toit pour les enfants pour la rentrée de septembre ». C’est donc de ce dernier dont on s’occupe en premier, en bonne méthode. Avec les moyens du bord. Etienne met alors en pratique une méthode d’échafaudage particulier que lui a appris un certain Gérard Barras et qui consiste à travailler en hauteur avec deux échelles collées l’une à l’autre. Pas sûr que l’inspection du travail corrobore, mais Gérard a remonté un village entier avec cette méthode, du côté du viel audon, alors… Méthode toujours : une fois à l’abri, on peut se consacrer à l’intérieur. Les travaux vont durer un an pour qu’une partie de l’habitation soit vraiment habitable.
Entre temps, la vie continue bien entendu et Etienne a rencontré celle qui sera la mère de trois autres enfants. Et commencé à enlever le tapis de ronces qui, avec les années d’inoccupation, a envahi l’intégralité du terrain, champ et bois.

la ferme... avant...

Au boulot donc...
Reste (encore !) à assurer la pitance. Les droits au chômage taris et ceux de l’invalidité insuffisants. Alors, encore une fois, Etienne regarde tout bonnement autour de lui. Vivre et travailler au pays qu’ils disent… Et lui, ce qu’il voit alentour, c’est un pays se désertifier, des écoles fermer, des fermes s’écrouler et des entreprises partir. Il voit aussi des besoins non satisfaits dans les fermes restantes alentour, des résidences secondaires en nombre et pas toujours entretenues, mais aussi des jeunes en quête d’autres choses que les mirages urbains et qui vivent parfois dans des conditions d’inconfort extrême, dans des épaves de camionnette, sous des tentes, des bâches tendues entre deux arbres et vivent de petits boulots saisonniers, de quelques biques, d’artisanat. Certains faisaient du woofing, même si le mot n’existait pas encore : nourri, logé mais sans statut, sans limitation d’horaires, sans salaires et ça se terminait bien sûr souvent en engueulade et frustration de tous côtés…
Il se souvient de ce dont lui parlaient tous ses anciens clients – agriculteurs, artisans, commerçants, artistes, enseignants – qui se désolaient du dépérissement du pays : les anciens vieillissent et leurs enfants s’expatrient, le pays s’embroussaille, les maisons s’écroulent… Au fond, il voit un peu la même chose que quand lui même a été accueilli par ce pays de châtaigne et de rocaille. Et il va naturellement reproduire la même chose que la première fois mais en proposant la démarche à d’autres, à qui veut : partir des besoins locaux pour aider les gens à s’installer, c’est à dire d’abord trouver un travail sur place. Des idées simples mais personne ne les a eues jusqu’ici. Ou alors personne n’avait essayé de les porter.
AMESUD : un nom comme un programme…
Tant et si bien qu’un beau jour de 1988, Etienne prend l’initiative de mettre en branle le mécanisme, réunit à Rocles les amis et connaissances du coin, anciens clients et connaissances motivées et tout ce monde crée dans la foulée une association qu’on appelle tout de suite AMESUD (Association Montagne Emploi Sud) pour aider les gens à l’installation dans le pays, une sorte de mélange de compagnonnage et de woofing avant l’heure : « L’idée est de donner un statut, une rémunération et de proposer un parcours initiatique de découverte des besoins du pays ainsi que l’organisation de stages en entreprise. Au fond créer une sorte de parcours où chacun fait ses choix et peut être accompagné. ».
Mais par où commencer ? Quand il en parle aux institutions, à la DDTE par exemple, il voit bien qu’on le prend poliment pour un illuminé. Etienne, lui, déroule toujours le fil d’Ariane de sa conviction et entend dire que l’association Peuple et Culture de l’Isère organise justement des stages d’accompagnement et d’installation en milieu rural. Alors, tout de go, il s’y inscrit. Durant trois mois. Le projet du stage étant justement de créer une structure d’accompagnement : vivre et travailler au pays on disait à l’époque. Ou quelque chose approchant. Ainsi, Etienne devient donc stagiaire d’une association dont il est aussi le président.
Trente ans de services
Là, notre homme décide d’arrêter son récit, revient sans transition au présent et me dit tout de go : « Bon sang, mais ce qu’il peut faire chaud ! C’est un pays de chaleur ici. L’été, c’est compliqué, ça l’est toujours pour moi, je suis resté un homme du Nord au fond, je suis obligé de me tremper dans le bassin devant la maison plusieurs fois par jour. Ou alors tu ne peux rien faire. ». Il passe sa main dans sa barbe, dans un geste qu’il a souvent quand l’humeur redevient vagabonde. Et puis tout à coup, « C’est l’heure de donner à manger aux lamas. Tu veux voir ? ». Et comment ! Donner à manger à un lama, rien de plus simple, parce que c’est une bête curieuse. Vraiment. Si bien qu’à peine a t-on pointé le bout des chaussures, qu’ils accourent en file indienne pour nous renifler sous toutes les coutures et nous accompagner sans faire d’histoire vers l’enclos où chacun a son seau accroché à une barrière et dans lequel Etienne verse quelques granulés d’un mélange de céréales. Ca doit être bon vu l’appétit de ces grosses bêtes, « ils sont très gourmets, ils ne mangent pas tout ce qui leur tombe sous les dents, ils trient beaucoup. ».
Au Macchu comme à la cham du Cros…
De là où on est, on a aussi une belle vue panoramique sur tout le pays, les villages en dessous de nous, les petites routes qui les relient, la rivière tout en bas. Je ne sais pas si les lamas apprécient, eux qui ont sûrement dans les gènes l’héritage de leurs ancêtres qui vécurent aux abords du Machu Picchu ; mais dans un autre genre, c’est aussi très beau à regarder ici. L’oeil est invité à s’arrêter, un peu en contrebas, sur la Grangette qu’Etienne a retapée en utilisant pour la charpente et le plancher un grand châtaignier qui était tombé sur le cabanon : « j’ai dit au châtaignier que puisque c’est lui qui a cassé la baraque, c’est lui qui va aider à la reconstruire, il y a quatorze poutres pour soutenir le toit. Toutes proviennent de cet arbre. ». Dont il subsiste encore une énorme souche. Il propose l’étage en gîte pour tous ceux qui veulent de la nature et du calme et le rez de chaussée sert aux lamas d’abri en cas de gros temps. C’est sommaire en terme de confort, la douche est solaire et en plein air, les toilettes sèches et l’éclairage minimum mais « j’ai remarqué que la sobriété, ça éloigne aussi les emmerdeurs, ceux qui ne sont jamais contents où à qui il manque toujours quelque chose. C’est très bien comme ça. Parce que du coup, on n’a que des bons rapports avec les vacanciers de passage, ceux qui recherchent le calme et l’authenticité et qui t’emmerdent pas parce qu’il manque la clim ou le Wifi, la télé ou un rond de serviettes ».

.
On continue notre ballade. Etienne a besoin de bouger. Comme ces poissons qui ne peuvent s’arrêter de nager sous peine de manquer d’air. Alors on marche. La pente est raide et on marche à travers les murets dont quelques uns s’écroulent. Délimitant sur toute la colline tout un système de terrassement. Des milliers de pierres déplacées et assemblées au cours des générations précédentes. Chaque fois que je les vois, ces murets de cailloux, je pense à la même chose : ils croyaient vraiment que ce qu’ils bâtissaient serait éternel, nos ancêtres. Comment comprendre cet acharnement sinon, cette rage de construire ? On passe à côté de puits creusés dans la roche, d’arbres souffrant visiblement du réchauffement climatique, de ce qui fut : des plantations d’arbres fruitiers, d’armatures où poussaient, il y a longtemps, des pieds de vigne. Du travail d’entretien en perspective encore.
D’hier à aujourd’hui : volem viure al pais.
Cette ferme, comme tout ce qui vit, a bien sûr une histoire : elle a abrité des générations de familles qui vivaient de cueillette de marrons, d’élevage de quadrupèdes en tous genres et qui se plurent à vivre dans ce pays, à trouver des sources, à en détourner le fruit pour faire pousser la pitance. On reste silencieux un instant. Peut être tous les deux entend t-on encore l’écho de leurs souffles résonner contre la rocaille ? Qu’on veut laisser palpiter ces souvenirs d’un ancien monde au fond de nous encore un moment ? Je me laisse imaginer la somme de dos courbés, de genoux endoloris sur cette terre aride, à en extraire jour après jour tout ce qu’elle veut bien donner. Penser combien toutes ces volontés font écho à celle de mon interlocuteur du jour, tout cette abnégation qui leur a fallu à tous, pour faire vivre ce lieu.
Vivre et travailler ici donc… Il est bien exigeant ce pays. Sans doute donne t-il beaucoup en retour. Je me plais à imaginer alors que c’est peut être pour cette raison, pour que je puisse sentir ça, moi aussi, qu’ Etienne fait un peu traîner la promenade. Les gens qui aiment un endroit, un morceau de musique, une recette de cuisine, une idée aiment souvent partager leur appétence. C’est ainsi.
Quand nos pas nous ramènent vers la maison, en sortant de la forêt comme d’un ensorcellement, Etienne reprend son récit naturellement. « Les premiers besoins qu’on repère, ce sont les besoins en remplacement dans les fermes évidemment. C’est le plus évident. Alors on crée AMESUD remplacement agricole. On fait une année de test et embauchons trois premiers salariés pour tourner sur les exploitations. Au bout d’un an, on a un service de remplacement autonome. Il existe encore. Beaucoup de filles qui ont un projet d’installation mais pas le capital. Au début, les paysans étaient surpris que ce soient surtout des femmes. Mais au bout du compte, ça a fini par pas mal de mariage ou de fondation de famille. » se marre Etienne.
Au delà de la galéjade, on touche peut être là ce qui constitue le cœur du projet d’AMESUD : mettre en relation des besoins et des gens avec un projet, créer des lieux de rencontre, des champs de possibilité, des convergences de destin. C’est ce que proposent Etienne et ceux qui l’accompagnement dans cette entreprise, qui conseillent et accompagnent bénévolement les porteurs de projet… Les premières installations réussies suscitent l’étonnement et l’intérêt des services préfectoraux : comment font-ils donc ceux-là pour que des gens réputés marginaux, souvent un peu méprisés et laissés pour compte par les organismes officiels, parviennent à réaliser leurs projets ?

Etienne à l'ouvrage dans les années 80
Et bien à peu près ainsi : les maires des petites communes soutiennent parce qu’ils y voient une aide pour dynamiser leur population et leur territoire. « Nous, on fait vraiment comme on peut, avec ce qu’on a sous le coude. Mais on y croit. On se débrouille avec les moyens du bord pour accompagner qui veut.». Le mouvement initié, les premiers succès, l’affluence des candidatures, l’intérêt des entreprises et collectivités locales s’affirmant, les institutions se rappellent à leur bon souvenir : « au bout de deux ans, vers 1991, il y a un conseiller emploi formation de la préfecture qui veut nous voir. Il n’y a pas de local à proprement parler, tout se passe chez moi, dans la grange qu’on aménage comme on peut, ni de salarié. On se débrouille encore avec les moyens du bord. On alterne les formations et les stages pratiques. On accompagne qui veut. Le type se montre vraiment intéressé par ce qu’on lui montre et on reçoit assez vite le statut d’organisme de formation. Comme un blanc seing nous ouvrant les portes d’un autre monde, avec les financements publics. Cette reconnaissance officielle nous permet enfin d’offrir un vrai statut de stagiaires aux gens dont on s’occupe. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. Et recruter nos premiers salariés. ».
Les relations avec les institutions ne sont pas toujours, pour autant, un long fleuve tranquille. Loin de là. Etienne se plaît à nous raconter un exemple significatif des incompréhensions liées au manque de culture commune. Les subventions appelant contrôle, un beau matin, une escouade d’inspecteurs de la direction départementale du travail arrive à la ferme pour faire son métier. Et ne met pas longtemps à comprendre qu’il y a visiblement hiatus entre le nombre officiel de stagiaires déclarés et ceux qui sont effectivement pris en charge à AMESUD. C’est que le travail est bien reconnu au niveau local et on fait désormais beaucoup appel à l’association : « On n’allait quand même pas refuser du monde ». Tant et si bien que le nombre de bénéficiaires réels est en fait beaucoup plus important que les déclarations préalables. Et où la situation devient burlesque, c’est que l’inspecteur se demande s’il n’y a pas de détournements de fonds. Etienne parvient à faire comprendre qu’on n’est pas vraiment dans la perspective du détournement dans lequel, par hypothèse, il s’agit de faire moins en touchant plus. Ici, en l’occurrence, on fait plutôt plus en touchant moins : une cinquantaine de stagiaires déclarés alors qu’on s’occupe plutôt d’une centaine par an. Ce n’est pas tout à fait la même histoire.
On finit pas se comprendre et cela permet à tous – et notamment aux services préfectoraux – – de prendre la mesure du fait que cette drôle de structure, si elle répond bel et bien à un besoin réel au niveau local, ne correspond à aucun dispositif existant alors. Il lui faut un nom – parce qu’il faut bien nommer les choses pour qu’elles existent, même en langue administrative – ce sera donc le « site de proximité » qui sera intégré sous cette appellation dans le contrat de plan Etat-Région de 1995. La quintessence de la reconnaissance officielle.
« Et là, d’un coup, on change de monde. Complètement. On se retrouve vite avec des budgets avec six chiffres. Et donc des contrôles beaucoup plus pointilleux évidemment. Une multiplication de réunions départementales, régionales, des interventions en colloque, des sollicitations médiatiques, des tonnes de paperasse à remplir, de rapports à rédiger. La grange est aménagée en 240 mètres carrés de salles de formation, de bureaux partagés. L’emploi de nos salariés, jusqu’ici tous au SMIC (du directeur à l’agent d’entretien) est garanti et mieux rémunéré. Nos intervenants sont bien rémunérés eux aussi, les stagiaires ont un vrai statut. Mais ici, du coup, l’ambiance a pas mal changé, y compris pour moi, qu’on envoie faire le VRP pour faire tourner la boutique ; alors que mon truc à moi, c’est de défricher le terrain, en pionnier les pieds dans la poussière, en contacts individuels, directs et discrets. Débardeur, short et sandalettes. Pas le costard cravate du commercial. On peut dire qu’AMESUD traverse, comme moi même, à ce moment là, une crise profonde. Appelons ça une crise de croissance. On se retrouve avec une valse de directeurs, les intervenants ont un peu perdu le sens de la mesure, attrapent la folie des grandeurs, y compris sur les salaires. L’argent rend fou. Il faut gérer toute une équipe, une dizaine de salariés, faire des ressources humaines quoi. Ici, les locaux deviennent trop petits et on mélange en permanence le privé et le professionnel. Ce n’était plus pour moi. J’ai compris ça. Je me retire en 1996. L’association s’est installée à Joyeuse. Elle y est toujours, a fêté l’année dernière ces trente ans et se porte très bien, avec une quinzaine de salariés. Le fil continue. C’est l’essentiel. J’étais d’ailleurs invité pour les trente ans, j’y suis allé avec plaisir, la plupart des gens ne savait pas qui je pouvais bien être. Et c’est très bien comme ça ».
Ici, impossible de savoir s’il y a un peu de dépit dans cette apparente satisfaction. Mais le plus probable est que non, tant tout indique que notre interlocuteur est bien plutôt un homme d’action que quelqu’un à se complaire dans le souvenir. De toute façon, il coupe court à mes tentatives de spéculation parce qu’éprouvant une fois encore le besoin de faire quelque chose de ses mains, voir la pointe de ses souliers s’activer devant lui, il me dit « Je vais te montrer la cave. C’est une belle pièce. Tu vas voir ». Et de fait, il m’emmène sous la terrasse, où, effectivement, de très belle voûtes abritent tout un capharnaüm d’objets liés à l’activité agricole : roues de char, restes de tracteur, outils en tous genre. Des bouteilles aussi sur des pans entiers de murs aux pierres apparentes avec leur toiles d’araignées géantes : on est quand même dans un pays qui produit du vin depuis des lustres.
Je digère d’ailleurs tout doucement celui du repas de midi. Un nectar réalisé dans la vallée voisine en biodynamie. De parfait aloi. Et tout au fond, là bas, à gauche, Etienne m’indique une cavité creusée dans la roche sur laquelle s’appuient les fondations de la bâtisse. Il s’agit d’un puits rempli d’une eau provenant d’une source et des gouttières du toit. Etienne me laisse deviner que ceci dit beaucoup de l’importance de l’eau dans ce pays et m’explique avec gourmandise le jour où la foudre est tombée sur la maison et passée par le puits. Entraînant un recul du mur de soutien de deux mètres – dûment refait depuis – et le déversement consécutif des 6000 litres dans la cave. La peur du cheval qui logeait là fait encore rire de bon cœur notre guide. Et quand il a fini de rigoler, il reprend volontiers son récit :
« A AMESUD, on n’accompagnait pas que des individus. On a fini par travailler aussi avec des associations, des communes, des collectivités. Par exemple, on a contribué à installer une activité d’artisan verrier à Laboule. Qui a un succès fou. On a fait construire un atelier adapté. D’autres artistes sont arrivés, des potiers, des céramistes. Maintenant, c’est devenu ce qu’on appelle un village d’artistes. Certains critiquent mais on avait quoi avant ? Un village en déshérence. On a aussi aidé à la création d’une boulangerie intercommunale à Rocles, qui fait d’excellents pains bio, de regroupements de producteurs, d’une coopérative autour de la transformation de la châtaigne où il a fallu construire un bâtiment où stocker et transformer, une chambre froide s’est donc avérée nécessaire. Et si on nous demandait notre aide, c’est bien que notre compétence était reconnue au plan local. C’est une grande satisfaction. Parce que ça, c’était notre raison d’être à AMESUD : faire avec, accompagner et en aucun cas faire à la place des gens avec qui on travaillait. Maintenant, c’est devenu une nouvelle norme avec les institutions intervenant dans l’aide aux porteurs de projet. Nouvelle appellation aussi. Avant on disait les stagiaires et rien de plus. C’est marrant, ces évolutions de langage. Mais à l’époque, on était un peu précurseur. Pas toujours compris du coup. Mais on a fait notre trou. Et maintenant, le travail d’accompagnement continue. Et c’est l’essentiel. Maintenant, la structure Amesud, c’est une quinzaine de salariés et autant de bénévoles. Qui œuvrent toujours à partir des besoins locaux et la mise en relation avec les projets des habitants qui veulent vivre et donc travailler ici. Ils sont dans de beaux locaux, financés par la communauté de communes, le département et la région. Il est loin le temps où on tapait, au fond de la grange, tous nos documents sur une vieille remington et où on faisait nos photocopies au stencil… ».

L’aventure FAMIDAC
Au mitan des années quatre vingt dix, Etienne se retrouve donc à nouveau sans emploi. Et comme, suite au déménagement des activités d’AMESUD et la débauche d’activité qui a été forcément été son corollaire pendant des années, la grande maison sonne un peu le creux et paraît bien grande d’un coup, c’est là que notre homme, et désormais Mimi qui partage sa vie, trouve dommage que tout cet espace reste inutilisé. Il a alors l’idée – et ce sera une idée de précurseur une fois encore : c’est une manie ! – de faire de l’accueil familial à destination des adultes aux prises avec avec des difficultés psychologiques et/ou sociales. A l’époque, ce qu’on appelle dans le langage courant les familles d’accueil, ça existe déjà bien sûr, mais ça ne concerne que les enfants, pas des adultes. Et encore moins des gens avec des handicaps mentaux. On laisse gérer ce public par les institutions sanitaires. Michel Foucault appelait ça « le grand enfermement », consécutif, selon lui, à l’émergence de la modernité politique, de l’individualisme triomphant et de la Raison et dans lequel les institutions – ecclésiastiques et étatiques – prétendent désormais gérer à la place des familles le « fou », l’inutile, le dépravé. Etienne, quant à lui, reprend plutôt sans barguigner sa truelle et son fil à plomb et aménage trois appartements dans ce qui était encore il y a peu les locaux d’AMESUD.
Et, ni plus ni moins parfaitement à rebours donc de l’histoire du traitement du paria depuis quatre siècles, il propose de le faire sortir de l’institution en l’accueillant à la maison. Une fois les travaux réalisés, il met en route l’activité avec un homme qui a subi un grave accident de la route et qui a donc perdu en autonomie.
Mais là encore, quand on est un précurseur, on ne peut bénéficier ni de l’expérience des autres, ni d’un réseau préalablement constitué, ni de l’aide publique. Alors, on se débrouille une fois de plus. On défriche. « On essaie de faire connaître ce qu’est l’accueil familial. Tous les copains me disent : mais faut faire de la publicité ! C’est pas mon truc, moi, la pub mais ils ont raison : il faut faire connaître notre activité auprès des médecins, des travailleurs sociaux.. Ca va coïncider grosso modo avec la démocratisation d’internet, on est en 1997. On crée donc à quelques uns une association qu’on appelle Famidac et je me lance dans la création d’un site. C’est la mode et c’est bien pratique, faut reconnaître. On acquiert rapidement un peu de notoriété. Tant et si bien qu’ un beau jour, on reçoit un coup de téléphone du ministère, ça surprend un peu ! ». Mais ce qui surprend encore plus, c’est l’objet du coup de fil : le type dit qu’il veut améliorer la loi qui encadre l’accueil familial et nous demande, à nous, ce qu’il peut faire pour ça !! Et bien, nous, c’est vrai que ça nous paraissait très clair, ce qu’il fallait faire…
Un peu publicitaire mais qui peut résister au plaisir de voir les bacchantes d'Etienne et les cheveux longs de MIMI ?

« Par exemple on gagnait que dalle encore avec cette activité. Il faut donc, nous semble t-il, d’abord créer un statut de l’accueillant, avec un minimum garanti qui pourrait tourner autour des trois mille francs par mois ( environ 500 euros : NDLR) par personne accueillie. C’est encore des francs encore à l’époque. Pour nourrir le cas échéant, loger, blanchir et proposer des activités aux résidents ». Rien n’est en effet prévu pour ceux qui pour qui l’autonomie ne va pas de soi, sans être complètement dépendant, en dehors des institutions sanitaires de type asile, foyer ou autre appellation dont sont friandes nos administrations. « Pour nous, l’objectif, c’est de leur permettre de reprendre pied et de proposer une ré-autonomisation. La durée moyenne du séjour est de quatre ans environ. Les résidents accueillis sont obligatoirement des adultes, peuvent accueillir ponctuellement leur famille sur place, ont leur espace d’autonomie, mais ils peuvent compter sur nous s’il y a une difficulté, pour faire les courses ou des sorties par exemple. C’est une alternative à l’établissement de soins où, comme en psychiatrie, tout le monde est avec tout le monde, on mélange tout ».
S’ensuivent donc des années d’allers-retours incessants aux ministères, à l’Assemblée Nationale pour de multiples auditions et modifications de lois. Au bout du compte, actuellement, il existe dix mille familles qui accueillent chez elle près de quinze mille personnes en difficulté, handicapées ou âgées.

Et voilà donc comment une idée de plus essaime. Germée dans cette caboche, derrière ce visage avenant qui me fait face cet après midi. Et qui m’annonce, avec une pointe de gravité, que c’est maintenant l’heure de la sacro sainte sieste. A laquelle il ne déroge jamais. Je comprends tout de suite que ce n’est pas une petite affaire : on ne plaisante pas avec le repos. Soit. En repartant, il me laisse donc seul et c’est Mimi qui vient aussitôt s’enquérir si je n’ai besoin de rien. Peut être discuter avec toi si tu as le temps ? Et voilà Mimi qui me raconte un peu de son histoire elle aussi. Mimi qui, malentendante, a donc passé ces premières années en étant considérée comme attardée alors qu’elle entendait juste mal ce qu’on lui disait. Mimi qui a du se débrouiller comme elle a pu avec son handicap à l’école. Qui a du travailler tôt à la boulangerie familiale du côté de Montélimar. Parce que ça se passait comme ça à l’époque. C’est la troisième femme à partager la vie d’Etienne. C’est elle qui insistera pour que je reparte le coffre lesté de victuailles confectionnées maison, à boire et à manger, comme si j’allais mourir de faim demain.
Et la roulotte...
Mimi, la si discrète compagne qu’Etienne rencontra, il y a deux décennies, au détour d’un couloir, à l’hôpital psychiatrique de Privas, où elle officiait comme documentaliste. Mimi, quand elle veut bien parler un peu d’elle, je vois bien qu’elle le fait plus par politesse, un peu comme on répond pour être poli, plus que par goût prononcé de cet égotisme bavard dont semble si friande l’époque. Comme si ça fait un peu partie de son devoir d’hôte… Et qui me fait soudain penser à ces « cœurs simples » dont parlait si bien Flaubert en d’autres temps… Qui s’y connaissait, l’ours de Croisset, à repérer les marques de l’innocence ordinaire, d’Emma à Félicité.
Au hameau : les jardins de Nelly
Une fois que Mimi est repartie à ses occupations, parce qu’elle en a toujours une, elle aussi, resté seul, je me décide d’aller découvrir un peu le pays alentour. Je prends donc l’appareil photo et emprunte la petite route qui passe devant la maison. En remontant les lacets de virages qui mènent à un petit village en surplomb, dont quasiment toutes les maisons, toutes habitées, sont refaites avec goût et se donnent au regard du visiteur parées de leurs plus beaux atours. On y trouve également un jardin visitable, ode à la biodiversité à lui tout seul, résultat des bons soins de Nelly depuis quarante ans. Un refus de mourir peut se sentir très vite dans l’air. Je me dis aussi, – l’association d’idées est elle si bizarre ? – que c’est peut être toujours un peu la même source d’énergie qui amène Etienne à partir de ses ressources – de quoi je dispose ? : un savoir manuel, une grande maison qui peut abriter bien des activités, une envie d’être utile – et des besoins des gens qui vivent alentour. J’essaie de comptabiliser le nombre de gens auquel cette maison quasiment reconstruite de ses mains a pu servir de rampe de lancement vers une autre vie, que ce soit dans le cadre d’AMESUD ou Famidac. Combien de gens ? Plusieurs centaines au total. Il fallait y penser : faire de sa propriété une sorte de bien commun.

Et ce constat prend une autre relief en déambulant dans les ruelles de ce petit village où les murs ne résonnent, pour le moment, d’aucune activité humaine, les habitants étant partis travailler chacun de son côté. Parce qu’ici, à force de volonté des uns et des autres, on peut travailler et vivre au pays. Beau succédané quand même des contradictions de notre monde – en transition paraît-il – , il est bien possible que nous nous trouvions ici, à la fois au bout du monde et au commencement d’un autre qui émerge et dont nos hôtes du jour sont des sortes de précurseurs. Peut être à leur cœur défendant. Mais avec le commun comme étendard.
Et peut être bien que toute une partie de notre époque pourrait être résumée dans cet espace-temps, localisé autour de ces quelques lacets de route. Je ne suis pas certain qu’ils le formuleraient ainsi, Etienne et Mimi. Pour autant qu’il me semble, ce sont plutôt des gens pragmatiques – plutôt du genre à se dire : essayons de vivre où nous l’avons décidé et comme on l’a choisi, en étant un peu utile aux autres – avec du cœur. Qui font feu de tout bois dans cet élan. Voilà ce à quoi je pense en tous cas dans les ruelles désertes de ce petit village si inutilement mignon pour le moment dans ses apprêts, ses petits jardinets et ses arrières cours où des pots de toute taille attendent leurs premières fleurs. Qui écloront sans doute au printemps.
Chez Etienne et Mimi, il y a aussi cette faculté à rester lucide sur ses limites : « Est ce que je suis capable de gérer une association devenue une petite entreprise ? Est ce que j’en ai envie ? Est ce que je suis assez cadrant pour accueillir tous les types de résidents sous mon toit ? Les expériences accumulées semblent montrer que non ». Etienne n’est pas homme à se raconter des histoires, il ne minimise pas les échecs, notamment avec un duo de jeunes toxicomanes qui partent un jour en laissant toutes leurs affaires et même… un chat et ne reviendront jamais. « Ils ne pensaient qu’à s’en aller et retourner vers les villes où ils pouvaient trouver de quoi se défoncer… J’ai pas vraiment su ce qu’il fallait faire.». Pas de fausse modestie non plus : il ne passe pas plus sous silence les réussites, tel cet homme, chef d’entreprise, qui subit un accident de moto et qui, devenu dépendant, insiste pour venir chez Etienne et Mimi, parce qu’il ne supporte par son nouvel état. Malgré une capacité à la mobilité réduite et un passage compliqué dans sa vie personnelle, un homme en plein naufrage en somme. « Ce monsieur, il montait et descendait les escaliers sur les fesses au début, à la force des poignets, pour bien montrer qu’il n’avait besoin de personne et qu’il était donc éligible à résider chez nous.
« C’est quoi, un bonheur de solitaire ? »
Mais il ne voulait pas de ce centre de rééducation fonctionnelle où il venait de passer onze années. Qu’est ce que tu veux dire ? A la fin, au bout de cinq ou six années, il est parti sur ses deux jambes et a pu louer un appartement en ville. Il faisait ses courses et tout… Au delà des aléas, ce que j’aime bien, c’est partager, je crois. J’ai fait dix ans de formation, vingt ans d’accueil. Ça, ça a concerné une bonne cinquantaine de personnes de dix-huit à soixante-dix-huit ans. Mais c’est égoïste en fait. Parce que le bonheur, on le partage. C’est quoi un bonheur de solitaire ? ».
Désormais à la retraite, il continue d’ailleurs de s’occuper du site de Famidac qui reçoit à peu près la bagatelle de cinq mille visites par jour. L’association n’a pas de salarié. Tout repose sur quelques bénévoles, des accueillants familiaux militants qui se relaient pour répondre aux demandes. Il y a du courrier, des remplacements inévitables chez les familles d’accueil à organiser… Ca prend du temps bien évidemment…
D’ailleurs, toujours à ces idées de partage du temps et des ressources disponibles, Etienne a maintenant laissé la moitié de la maison à une de ses filles qui y vit avec sa compagne : parce que c’est quoi un bonheur de solitaire… ? Et comme c’est quelqu’un qui dit aimer sa solitude qui nous le dit, alors on peut certainement le croire. Comme quand le grincheux de Croisset nous parle de l’innocence qui est finalement partout si on prend la peine de la chercher… Et elle peut être parfois sacrément têtue dans ses formes, foi d’alsacien…

Biblio :
Michel Foucault : « Histoire de la folie à l’âge classique », gallimard, Paris, 1961
Gustave Flaubert : ‘Emma Bovary » et « un coeur simple », in coll. poche.
Amesud : site internet très complet sur les activités de l’association et présentation de l’équipe y ouvrant au quotidien, au service des porteurs de projet et du développement local.
Famidac : site internet sur ce mode d’acceuil inventé au fil de l’eau par Etienne et quelques uns.