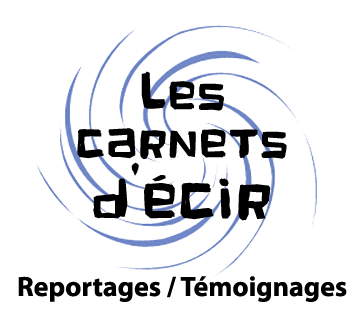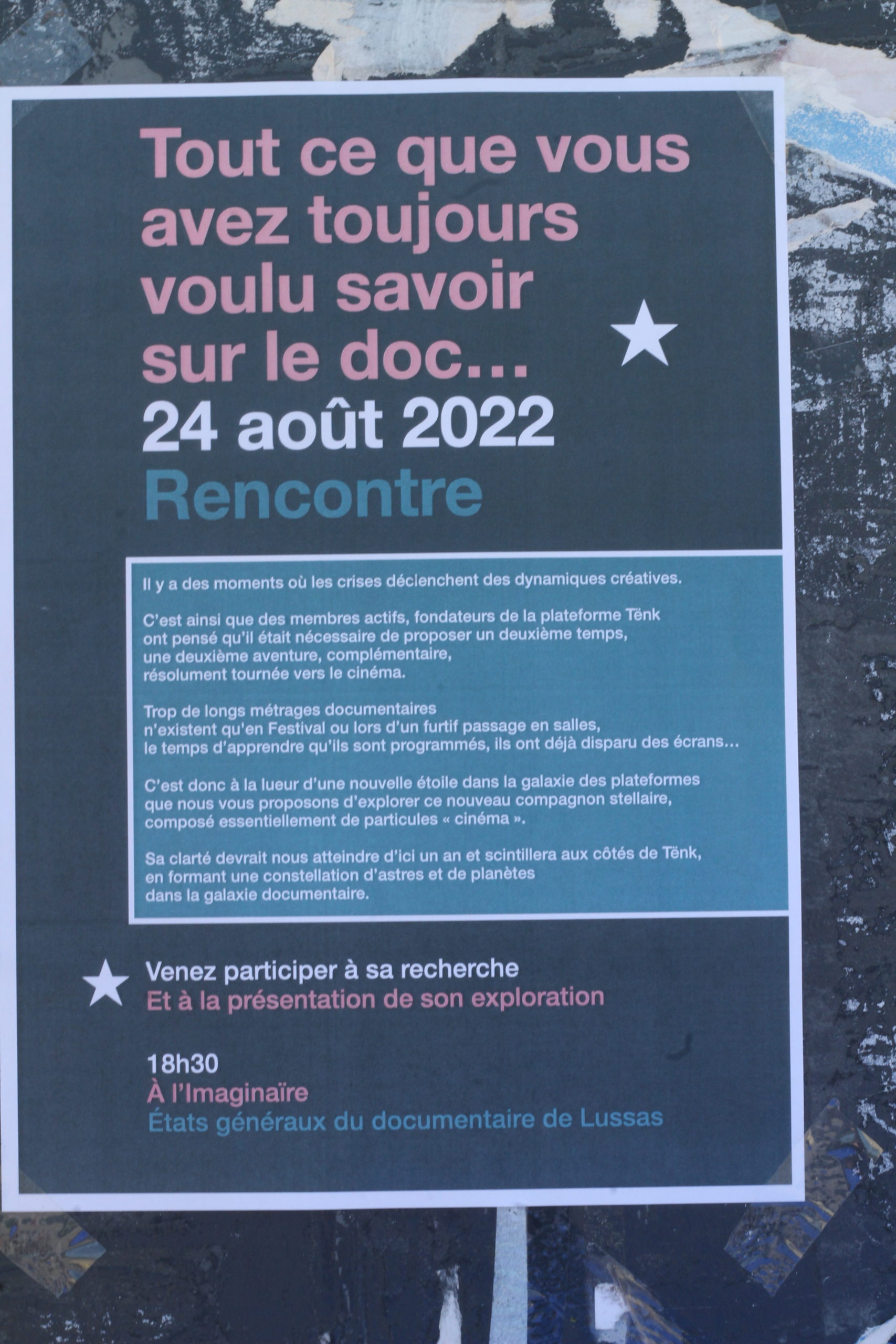JM Barbe : l'amour du réel et de son patelin
Un village documentaire pour la suite du monde....
Pour la suite du monde donc… C’est ce que lance notre bonhomme, un beau jour de 2018, à toute une foule venue inaugurer le bâtiment de l’imaginaïre, pour mieux en justifier la construction à quelques encablures du centre de Lussas, 1129 habitants aux dernières nouvelles ; espace flambant neuf donc, résumé architectural matérialisant cette ambition d’inscrire dans le paysage quelque chose de tout ce qui a été entrepris autour du documentaire dans ce bout de plateau ardéchois depuis un bon tiers de siècle maintenant… Et qu’on entend bien léguer au futur donc.. Qu’il en soit ainsi…

Jean Marie chez lui...
Le bonhomme, c’est Jean Marie Barbe : auteur, producteur, créateur ( mettez donc un co devant chaque casquette du sieur – parce qu’on ne fait pas grand chose tout seul – mais nous y reviendrons) du festival des Etats Généraux de Lussas et de tout ce qui se fait autour du documentaire dans ce joli coin de France depuis quarante ans…. Une vie d’adulte en somme. Et l’histoire, ce pourrait être celle d’un titi ardéchois foudroyé un soir comme un autre par l’évidence du cinéma, des morceaux d’histoires plantés sur une pellicule qu’on fait défiler devant votre nez vingt quatre fois par seconde au fond d’une salle obscure, en l’occurrence là celle du foyer rural du village.
Ce pourrait tout aussi bien être l’histoire du même petit gars qui voulait tout bonnement rester vivre au pays. Et qui, à force de bouts de chaussures glissés dans des portes ouvrant sur des univers tellement éloignés de l’épicerie familiale qui l’a vu grandir, armé d’une curiosité insatiable pour le monde tel qu’il va ou tel qu’il devrait aller, a bel et bien fini par réaliser quelques uns de ces désirs qu’on forge dans les secrets de l’enfance et qui, au bout du compte, fabriquent parfois un destin aux plus entêtés : à savoir pour Jean Marie, faire du cinéma et rester en son village.
A t-il déjà tout ça en tête quand, adolescents, ils partent en virée le samedi, lui et sa bande, au cinéma à Aubenas, enfourchant leurs mobylettes bleues ou orange, c’est selon, mais toutes unanimement pétaradantes ? Imagine t-il déjà ce qui l’attend quand, lors d’une de ces projections – le satyricon de Fellini par exemple – il reste tout seul calé dans sa banquette quand tous les autres partent au bout de dix minutes ? Sans doute que non bien entendu. D’abord parce qu’il n’est pas homme à planifier une destinée, encore moins une carrière, tout laisse bien plutôt à penser qu’il est bien davantage quelqu’un à suivre des intuitions, voir où ça peut bien mener. Ce serait son quoi qu’il en coûte à lui… Etant entendu aussi que vous ne lui ferez pas faire ce qu’il n’a pas décidé de faire : l’homme est aussi un brin cabochard. C’est ainsi.
De fait, ces deux constantes – le cinéma et le pays -émergent très vite dans l’imaginaire du jeune Jean Marie. Et pour rester au pays, il lui faut faire comme tout le monde, chercher de quoi assurer sa subsistance, lui qui n’a d’appétence ni pour le travail de la vigne, ni pour les arbres fruitiers, base de l’économie locale : ce devait donc être fatalement, tôt ou tard, le cinéma et plus particulièrement, de rencontres en rencontres, de festivals en festivals, ça se précisera assez rapidement, dés la fin des années soixante-dix, en direction du film documentaire, « parce qu’il dit le mieux le monde » et aussi, plus trivialement, parce qu’il coûte bien moins cher à fabriquer quand on ne veut pas quitter le pays et qu’on ne dispose pas de moyens à disposition, que ce soit le dieu argent ou le carnet d’adresse des gens nés où il faut…
Parce que le lieu, c’est vite une évidence, et le restera, ce sera Lussas, au milieu du plateau du Coiron, toisant sans vergogne la bonne ville d’Aubenas et la barrière des monts du Vivarais dans la même perspective. Devenu depuis un véritable « village du documentaire », désormais bel et bien inscrit à l’agenda de tous les gens qui s’intéressent au cinéma du réel de par le vaste monde. Un exemple parmi tant d’autres pour finir de se convaincre de cette universalité lussassienne ? Ecoutons Pierre Mathéeus, un autre de ces architectes d’univers passés par ce lieu, en première ligne de la création de Tenk et du bâtiment de l’imaginaïre qui nous explique que, se trouvant au fin fond du Mozambique quand il apprend qu’il est embauché à Lussas et que, le disant autour de lui, quelqu’un dans l’assistance lance : « Ah ! Lussas, c’est pour le documentaire alors… ». Il est des échos qui nous échappent parfois…
Un village donc comme il y en tant dans nos contrées. Comme les chantent Brassens. Comme aiment à mettre en exergue les affiches électorales. Comme ceux, dans la mythologie hexagonale, depuis Uderzo et Goscinny, dont on s’accorde à penser qu’un village n’en est en effet pas tout à fait un s’il n’a pas sécrété en son sein son Astérix. Et là bas, du côté de Lussas, suivez mon regard : qui d’autre que Jean Marie pour le rôle ? Et si l’on accepte de suivre cette pente, il est ensuite bien facile d’imaginer Jean Paul Roux, maire de la commune, en celui du chef Abraracourcix. Le bouclier en moins. Mais assurément le même appétit pour son bout de territoire.
.
Aubenas et le Vivarais depuis le plateau du coiron.


Lussas : carrefour
Mais revenons à nos brebis (parce que l’Ardéche…!). Quelques données pour vous permettre de vous fixer les idées et comprendre un peu mieux de quoi on va vous parler : le bien nommé « village documentaire » à Lussas, se présente donc comme une entreprise multiforme, construite, une marche après l’autre, tout au long des trente dernières années, et toute entière dévouée à la promotion d’une certaine idée du film documentaire : il faut que l’on puisse sentir, derrière les images, la voix, la respiration, les tripes, l’intimité d’un auteur. C’est une marque de fabrique, ce qui distingue le lieu du reste du monde : tout est tendu vers la possibilité de l’expression d’un regard particulier et de sa diffusion au plus grand nombre. C’est à cette condition, estime t-on par ici, qu’on peut au mieux « documenter le monde ». Il faut d’abord avoir ceci à l’esprit pour comprendre un peu mieux Lussas nous semble t-il. Parce que là est sa spécificité.
D’abord cet esprit s’incarne dans un festival au cœur du mois d’août ( 34 ème édition cet été), les Etats Généraux du documentaire, réunissant chaque année quelques milliers de chalands, professionnels de la profession ou simples curieux, autour de cet « art du réel » et des quatre rues qui se croisent au milieu du village.
Il nous semble qu’on va un peu à Lussas comme on va à Lourdes, espérant à chaque festival, que s’opère cette espèce d’annonciation d’autres visions du réel ainsi que la matérialisation d’une communauté de curieux du monde qui aiment être surpris : « Eclairer, jour après jour, éclairer ; amener à chaque instant le jus dans cette cité de la mémoire et de la représentation pour qu’existe autre chose qu’une impasse glauque, qu’un cul de sac, qu’une voie du réel » affirme Jean Marie, naturellement lyrique, dans son édito présentant le premier festival en 1989, où on fête à la façon lussassienne le bicentenaire de la Révolution Française, sous le titre qui est déjà un programme en soi : « Allumeurs de réverbères » : Ah ça ira, ça ira… donc.
Lussas, village documentaire…
C’est aussi, au fil du temps, toute une économie qui s’est progressivement créée au sein de la bourgade : est apparu ainsi, en 1983, la maison de production Ardèche Image Production qui, comme son nom l’indique, entend œuvrer à la production de films. Mais aussi, empreinte encore et toujours de cette constante volonté de pérennisation, la mise en place d’une véritable école du documentaire en partenariat avec l’université de Grenoble proposant un master qui forme une quinzaine de réalisateurs et de producteurs chaque année depuis vingt ans ; et puis encore dans le même esprit une vidéothèque qui réunit des dizaines de milliers de références à la disposition de tous, véritable mémoire du doc… Et la dernière née évidemment : une télé en bonne et due forme, ou plate-forme de diffusion, appelez ça comme vous voulez, dénommée Tenk ( « résume moi ta pensée » en langue Wolof), créée en 2016, et qui revendique aujourd’hui plus de dix mille abonnés…
Et concomitamment donc, pour rassembler tout ce monde au même endroit, éparpillé jusqu’à alors, dans les recoins du village, s’est érigée une structure de verre et de béton, à quelques encablures du cœur du village, la bien nommée l’Imaginaïre donc ( dans le pays, ça veut dire rêveur, être un peu perché si vous préférez) et qui a pour vocation de réunir tous les talents et compétences oeuvrant autour du documentaire : soit pas loin d’une cinquantaine de personnes travaillant autour de la création, montage, diffusion, d’archivage, de la mémoire, de l’enseignement d’une méthode. L’idée générale qui émerge petit à petit est d’avoir tout à portée de main pour qui veut fabriquer son film : société de production, studio d’enregistrement, logistique, formation, rencontres… Et surtout l’émulation des pairs… Et bien sûr, ça marche… Non sans difficultés évidemment mais quand même… C’est là… Et bien là…

Lussas et son écrin du coiron..
Le duo Barbe/Roux en son empire …
Tout ceci, bien entendu, c’est bien vite résumé sous le stylo mais rien de tout ça, vous vous en serez douté, ne s’est fait du jour au lendemain, d’un coup de cuillère à pot. Mille destins sont en effet venus croiser, un jour ou l’autre, autour du sillon creusé par le duo Barbe-Roux ( Avec le même esprit de croisade que l’illustre chef du Saint Empire Germanique ?). Ici aussi, tant d’énergies ont convergé dans le coiron un jour ou l’autre. Autant de parcours, d’envies, de projets particuliers. Formant encore et toujours histoire. Mille bifurcations, autant de destins percutés. Mais dans le flux, nul ne contestera que ces deux-là, le maire et le fils de l’épicière, de fait, on l’a dit, s’imposent d’eux même. Se relayant au volant, à l’avant du tracteur. Comme Jean Paul aimait à traverser son village. Creusant et labourant tous deux sans relâche le même sillon depuis quatre décennies.
Celui du désormais à jamais regretté Jean Paul Roux, parti cette année de l’autre côté du monde, dont le cœur en même temps que celui de tous ceux qui l’ont connu, s’est définitivement serré un matin de pêche. En sa commune. Dont il a été continûment l’Abraracourcix, dûment élu et non moins estimé de ses administrés, alignant autant de mandats que d’élections durant toute cette folle histoire. Lui, que, viticulteur de père en fils, rien ne prédestinait à la défense du documentaire d’auteur et qui, pourtant, durant toutes ces années, en fût un irréductible partisan. Lui dont la pudeur naturelle se méfiait tant des images. Jusqu’à la construction de ce laboratoire de l’Imaginaïre à trois millions d’euros sur ses terres (et cela n’a pas toujours été une sinécure auprès de certains de ses administrés, légitimement inquiets de ce qui se construit sur le territoire et des deniers publics). Ses raisons intimes, qui les connaît ? En tous cas, pas moi, au moment où j’écris ses lignes. Mais sans doute son amitié, une bonne vieille amitié acquise sur les bancs de la communale, avec l’ami Jean Marie, de la même classe 55, n’y est pas étrangère.
C’est évidemment ce dernier qui peut en parler mieux qu’on ne saurait le faire. Ecoutons le donc, prendre la parole dans les hommages rendus par toute une communauté, lors des obsèques d’abord où l’église de Lussas paraissait bien petite d’un coup ; par le monde du documentaire ensuite, lors d’un pot d’honneur organisé au coeur du festival de cette année, au pied de cet olivier planté pour le souvenir le long du petit chemin reliant le village à l’Imaginaïre, comme une façon de boucler un destin : « En fait, Jean Paul, s’il fallait te résumer, je dirais dans la tradition catholique qui était la tienne que tu étais un homme de paix… Nous n’avons pas de panthéon pour célébrer les femmes et les hommes humbles citoyens, mais nous avons ensemble une maison commune, celle du bien commun dont tu resteras à jamais l’un des plus justes bâtisseurs… Avec le temps, tu n’étais plus le maire de Lussas, tu es Lussas… ». Pas besoin de rajouter autre chose ici… Si ce n’est le souhait que Jean Paul repose en paix…

Hommage à Jean Paul. 24 Aout 2022. Jean Marie aux côtés de Madame Roux

L'olivier du souvenir entre l'imaginaÎre et le village : où d'autre ?
Le deuxième de ces destins, c’est bien évidemment celui de l’auteur de l’épitaphe ci dessus : Jean Marie Barbe, ci devant fils de l’épicière et qui nous occupe particulièrement ici. Tombé amoureux du cinéma comme d’autres se trouvent touchés par la grâce, lors de soirées de projection organisées par l’Amicale Laïque du village dont son père et son oncle se trouvent être des propagandistes zélés. Lui, c’est encore un gosse, il ne sait pas encore ce qu’est le documentaire, ni même qu’existe cette entreprise étrange de rencontre du réel et de l’image, mais déjà ce qu’il voit sur les écrans l’embarque définitivement vers d’autres ailleurs : un visage, un paysage, une lumière lors d’une soirée de projection mieux réussie qu’une autre ? Un peu plus tard un scénario de Ken Loach, un travelling de Jean Rouch ? Une interview de Chris Maker dans un vieux magazine qui traîne un jour sur le comptoir de l’épicerie ? A quoi bon savoir au bout du compte ? Parce que toujours est-il que, pour le restant de ses jours, l’affaire est entendue et c’est bien au service du septième art qu’il mettra toute sa détermination.
Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le bonhomme en a à revendre. Et qu’il peut être têtu. Et même tête brûlée à l’occasion. Depuis la première association le blayou ( ne cherchez pas dans vos vieux dictionnaires d’Occitan, c’est le nom du chien d’un copain !) jusqu’aux Dockers : idée dernièrement née en attendant la suivante, une association de convivialité et de documentaire à déguster entre amis et voisins autour d’un apéro, d’un goûter, d’un repas, de ce que vous voudrez mais à plusieurs. A ce propos, il faudrait sans doute faire un livre un jour sur l’histoire de la convivialité dans l’ensemble des entreprises barbiennes, il y aurait certainement beaucoup à dire ; ce ne sont pas les habitués des états généraux qui diront le contraire, invités à parler de ce qu’ils viennent de voir et d’entendre autour de grandes tablées occupant toute la rue principale du village où tout invite au croisement des points de vue et des échanges. Telle une agora du doc. Ici, comme souvent chez Jean Marie, la pensée se conjugue facilement avec la discussion, le doux fracas des idées qu’on échange.
Un côté socratique peut être : on resterait entre méditerranéens après tout.
Convivialité donc...
Chaises, tables, cuisine...
Une vie intense
Lui, il nous racontera volontiers l’amitié et le cinéma un jour, se définissant facilement comme quelqu’un ayant toujours aimé vivre en groupe, au sein du foyer familial d’abord, dans l’arrière boutique où « il y a toujours du monde autour de la table », celui du foyer des jeunes de Lussas ensuite, à l’origine de beaucoup de l’énergie déployée dans ce morceau du monde, jusqu’à celle de la bande à Lumière, aréopage d’artisans du film documentaire, en passant par les colporteurs de récits et les copains « folkeux » des premiers festivals organisés, des premiers films tournés. Parce que c’est vite devenu une manie, d’organiser des festivals, comme on va le voir plus loin. Mais ça occupe son homme. Et plutôt deux fois qu’une ! Qu’importe : un autre jour, en sa demeure, il nous dira : « je voulais mener une vie intense, je l’ai toujours voulu ainsi. ».
Et bien, il a été servi… Si sa passion du cinéma d’abord, du documentaire ensuite l’a effectivement amené, par le biais des images, à convoquer petit à petit une bonne partie du monde dans son village natal, réciproquement cela lui aura permis de parcourir bien des contrées lointaines – puisqu’on vous dit qu’il y a quelque chose ici du moustachu de Goscinny ! – dans la tunique de pèlerin au service de la volonté d’essaimer le modèle lussassien sur tous les continents. Autour du doc et du regard de ceux qui le fabriquent comme clé de lecture du réel, voilà bien, nous semble t-il, une constante depuis longtemps dans le parcours de notre bonhomme qui reconnaît sans fard qu’il « a tout appris du monde à travers les images ». L’oeil facilement rieur, jamais de forfanterie, une très grande facilité d’accès, il apparaît d’emblée sympathique, c’est ainsi. On ne peine donc pas beaucoup à comprendre comment tellement de gens ont pu être entraîné dans son sillage un jour ou l’autre, ni pourquoi : « C’est toujours gratifiant de travailler avec quelqu’un comme lui » nous confie un jour Pierre Mathéeus, qui l’a beaucoup pratiqué au quotidien, le temps qu’a duré la construction concomitante de Tenk et de l’imaginaïre.
Mais pas d’angélisme non plus : on peut aussi deviner qu’il puisse vite montrer les dents s’il estime que l’important est en jeu. Ou même susciter mécontentement et incompréhensions autour de lui. Comme le montre si nettement certains passages du film qu’a consacré Claire Simon aux trois ans de fabrication de la plate-forme Tenk. Où quelqu’un dit un moment quelque chose comme : « avec toi, Jean marie, c’est toujours plus. mais jamais suffisant ». Tout aussi bien que dans certains échanges dont on a été témoin autour de la création à venir – pour le moins discutée – d’une deuxième plateforme numérique consacrée au documentaire, « second étage de la fusée », après Tenk, pensée en tous cas comme telle par Jean Marie et quelques uns autour de lui. Il reste quand même un méditerranéen, certainement pas un type sans aspérité, rechignant à la castagne verbale si elle est nécessaire. C’est encore Pierre qui peut en parler le mieux : » Jean Marie, c’est quelqu’un qui défend ses idées. Toujours. Et il va vraiment au bout des arguments. Mais il est capable d’écouter ceux de l’interlocuteur. Et même de changer de vie. Mais il faut le convaincre…«

L'imaginaiïre côté village.

D’autres vies que la sienne…
Le destin que s’est fabriqué Jean Marie sera donc de devenir l’un de ces réverbères plantés le long des chemins de la connaissance du monde et du réel. Un parmi tant d’autres. Mais aussi, et c’est ce qui fonde, nous semble t-il, la spécificité de son parcours, il s’agira aussi très vite de faire en sorte que d’autres autour de lui puissent aussi s’exprimer, en aient les moyens. « D’autres vies que la mienne » donc comme le dirait Emmanuel Carrère (1)… On ne peut pas comprendre, au moins un peu, nous semble t-il, le parcours de Jean Marie si on n’a pas ceci dans un coin de l’esprit. Parcours qui oscille depuis longtemps maintenant entre ces deux pôles indissociables et pourtant pas toujours complémentaires, les journées n’ayant que vingt quatre heure, même celles de Jean Marie : raconter ses propres histoires, permettre aux autres de raconter les leurs. Les deux facettes d’une même passion qui vont faire le destin particulier de notre homme. Jusqu’à aujourd’hui, c’est d’ailleurs toujours le cas : on l’a vu récemment encore s’interroger devant nous sur ce qu’il devait prioriser, réaliser un film en projet depuis longtemps ou concentrer ses efforts sur la création de cette seconde plateforme consacrée au documentaire dans tous ces états.

Docs en plein air : on regarde, on discute...
Le sujet fait débat, c’est le moins qu’on puisse dire (!), autour de Jean Marie, qui a d’abord proposé le projet aux gestionnaires et associés de Tenk, avant que de se retrouver en minorité au sein du conseil d’administration de Tenk sur la question. On a assisté, au milieu des Etats Généraux de cette année, à une réunion où les antagonismes et incompréhensions sur le sujet étaient encore bien prégnants. Du coup, Jean Marie et ses amis ont décidé, pour l’instant, de lancer un projet indépendant. C’est toujours en cours. Le dernier film à tourner attendra donc.
Nous, on a voulu comprendre un peu mieux le bonhomme et son parcours. Il nous a donc fallu aller le rencontrer en son antre, là où il réside, aux côtés de sa compagne, Joelle et de l’impavide Freud, chien de son état. Entouré des siens, dans la vieille ferme familiale restaurée sans fioritures, dominant sans manière un petit vallon, du côté de Villeneuve de Berg. Deux antiques voitures garées devant la terrasse, dont une n’a pas survécu au dernier contrôle technique… Aller le voir n’est pas bien difficile tant l’homme, quand il prend un peu de repos chez lui, est spontanément accueillant : l’apéro est vite sur la table, avec un fromage du pays et un morceau de pain. Notre hôte ira même, un soir, jusqu’à mettre un point d’honneur à rater toute une série de crêpes avec une constance dans l’échec qui appelle forcément le respect : l’anti bling-bling personnifié… Par contre, faut être juste, sa confiture de myrtille est exceptionnelle…
Pour essayer peut être de vous donner une idée plus précise du genre de personne à qui on a affaire ici, il se trouve que Jean Marie traîne une saloperie, une maladie qui ne regarde que lui, ramenée il y a longtemps d’un voyage en Algérie, qui l’oblige à des hospitalisations régulières ; mais lui, quand il n’est pas obligé de courir les couloirs hospitaliers et les blouses blanches, sa préoccupation première et son feu intérieur inentamé concernent plutôt l’avenir de Tenk et d’une idée qui améliorerait, selon lui, l’existant du village documentaire, encore et toujours missionnaire au service de la cause du cinéma du réel dont il demeure – et sera vraisemblablement pour toujours – un ambassadeur infatigable partout à chaque fois qu’on le sollicite ( et c’est souvent tant sa voix compte dans ce petit monde : ne vient t-il pas tout juste de recevoir un prix de la SCAM, le syndicat de ceux qui fabriquent le cinéma, remis chaque année à quelqu’un pour saluer « celles et ceux qui, par leur engagement, œuvrent en faveur des autrices et des auteurs, de la culture et de la création »…).

En son refuge....
Mais écoutons le plutôt un moment :
J’ai une enfance de rêve…
« Mon père et mon oncle, autour de l’instituteur et de l’amicale Laïque, avaient acheté un projecteur Horton et nous montraient des films à l’école. Ils ont même très vite essayé de créer une salle des fêtes pour les projections. J’ai chopé le virus, je crois, à ce moment là. Quelques années plus tard, au collège de Villeneuve de Berg, où je suis pensionnaire, on diffuse des films qu’on prend dans le catalogue UFOLEIS. Un par quinzaine. Après encore, c’est naturellement que tu te retrouves, à quinze ans, à passer encore et toujours du cinéma au foyer de jeunes à Lussas. Le samedi, on va jusqu’à Aubenas sur nos vieilles mobylettes, pour voir d’autres films… Au lycée, ça continue bien sûr : on a une piaule avec deux copains et évidemment, on monte un cine-club… J’ai une copine un moment qui aime la littérature. Moi, je ne connais pas bien mais je découvre : « La recherche du temps perdu » notamment… J’ai toujours un engouement profond pour les films mais je suis paresseux pour les livres, même si, en quatrième, en troisième, je lis beaucoup. Des trucs très politiques, de chez Maspero. L’époque est maoïste et moi, je suis curieux du marxisme. De toute façon, la politique, on peut dire que j’ai toujours baigné dedans.
Soirée crêpes...

Ciel nocturne au dessus du coiron...
A la maison, il y a une ambiance politique, de discussions avec les uns ou les autres. J’ai une enfance de rêve. Dans des univers différents. La maison familiale est toujours pleine, tout le village passe à l’épicerie, mes cousins vivent avec nous. Mon père et mon oncle qui sont associés ont trois camions et font l’expédition de fruits. Ils m’amènent au marché de Marseille, à Rungis. J’y côtoie le monde des routiers, des maraîchers. Au final, je dois aussi beaucoup à l’école. Je passe un bac B (série économique et sociale : NDLR). Je suis très actif en cours mais je choisis mes matières. Après le bac, parce qu’il faut bien faire quelque chose, je m’inscris en fac d’éco à Grenoble, mais c’est surtout pour faire plaisir aux parents, je ne mets les pieds dans aucun cours. Par contre, il y a un certificat en sociologie qui se crée, où je m’inscris, qui est consacré à la communication. On est une vingtaine, c’est hyperpolitisé et assez violent entre les différents courants. Ca dure trois mois. Jusqu’à une grève où on prend la tangente avec deux copains de promo et où on vient faire un film ici (avec un petit camescope ¼ pouce AKAÏ ) sur l’état du monde rural, autour de néo-ruraux ou de copains paysans. On fait le film et on le montre à Aubenas.
Fils de l’éducation populaire…
En 75, je me retrouve objecteur de conscience, il y a le larzac pas loin, on est tous très anti nucléaire. Il y a une communauté d’esprit qui se retrouve autour de l’occitan et du folk. Je suis très libertaire, anti état central, et je commence à me dire que si on n’arrive pas à changer le village, on ne changera pas plus le monde. Disons que c’est en gros mon état d’esprit d’alors : « Volem viure al pais ». Et aussi j’aime bien l’idée du village-monde. Je ne suis pas du tout un militant de base acharné, mais je suis très politisé quand même, disons que c’est mon état d’esprit du moment. J’ai l’occasion alors de faire un stage au centre socio-culturel d’Aubenas, on fait des petits reportages.
reportage : panoramas sur l'imaginaÏre.

Mais c’est justement à ce moment là qu’intervient une certaine rupture avec le village. On est donc tous très mobilisé et on a créé un comité Larzac (NDLR : une grosse lutte emblématique des années soixante-dix contre un projet d’extension d’un camp militaire au milieu du plateau, au dessus de Millau, dans l’Aveyron). A Lussas on a une mairie de droite qui nous annonce des manœuvres de l’armée autour de Lussas. Les copains paysans ne bougent pas. Je propose au maire d’organiser, avec le foyer des jeunes, une projection débat du film Gardarem lou Larzac – « Le foyer des jeunes. C’était une sorte de deuxième famille. On y était accepté à partir de quinze ans, certains y étaient encore à trente cinq ans ! Filles et garçons y étaient mêlés. On oublierait tout si on ne racontait pas les années du foyer des jeunes qui rassemblait une bonne partie des jeunes et nous en avons entrepris des choses ensemble : les conférences, le ciné-club, les stages de kayak, de danse, c’est comme ça que l’on appris à danser le rock.. Cette salle des fêtes du foyer rural, on ne dira jamais assez combien elle a permis de générer d’événements » (2) -. Mais la mairie s’y oppose. Mais on le fait quand même, avec des copains antimilitaristes et des objecteurs de conscience. Et le jour des manœuvres, on se retrouve à une vingtaine à défiler sous la bannière « L’armée triomphe, le pays crève ». C’est moi qui vais être accusé d’avoir organisé cette manifestation (ce qui n’est pas faux). A partir de là, les rapports sont devenus extrêmement tendus avec la grande majorité des habitants de Lussas. Le maire a même porté plainte. Comme on dit, j’ai un peu pris le maquis pendant quinze jours. Un flic communiste a aussi un peu fermé les yeux à un moment. Et ça a fini par passer. Mais j’ai senti le souffre pendant vingt ans ».
Vous avez dit tête brûlée ?
« Mais ça n’entame pas ma volonté de faire des choses ici. Je comprends quand même qu’il faut que je prenne un peu le large et que je m’occupe de mon futur. Je reprends donc la fac presque un an. Dans un IUT d’animation carrières sociales. Qui forme des directeurs de structures d’animation MJC et autres centres socio-culturels. Mais ils me virent parce qu’on fait une grève dont je me souviens même plus le motif. Où, c’est vrai, je suis un peu moteur ! Du coup, je n’ai toujours aucun diplôme, mais pas mal d’expériences intéressantes.
Cinéma paradiso…
Comme celle qu’on fait avec le musée dauphinois de Grenoble. Où on collecte des témoignages en faisant de l’ethnologie. Et c’est là où je me dis comme une évidence que c’est possible de faire la même chose en Ardèche. Qu’il faut faire la même chose. Et qu’il faut aussi en tirer un film. Je me mets donc en quête et quand on cherche on finit souvent par trouver : un jour, je rencontre donc des gens à Aubenas qui s’occupe de la diffusion des films et de reportages, des trucs du type Connaissance du Monde. Ils reviennent d’Afghanistan et nous, on les admire bien sûr un peu et on leur dit qu’on veut faire un film sur les traditions orales du plateau du Coiron. Ils pourraient s’occuper de la diffusion. On se met d’accord et c’est parti : on réussit à grappiller une petite somme, l’équivalent de 1000 euros auprès du musée dauphinois et durant l’été 76, avec les copains des bals folk, on écume donc le terrain, on collecte des chants, des danses, des récits. On repère des lieux. Des gens, néo-ruraux, paysans, bergers. Mais je ne sais pas bien filmer évidemment ! Du coup je réalise les entretiens, Marie Odile Méjean fait le son, Jean-Jacques Ravaux est à la camera. Le tournage et le montage nous prendront un an. Le film s’appellera Benleù ben. Et moi, sur un plan personnel, j’y rencontre Marie Odile Méjean avec qui on fera un enfant plus tard. Le film est monté et montré d’abord dans le centre socio-culturel d’Aubenas devant une centaine de personnes et puis tournera, plus de 800 projections en 30 ans, dans le circuit ciné dont s’occupe Jean jacques Ravaux .
Après, on se retrouve à quatre à se dire que ce serait bien de développer un truc dans le cinéma ici, au pays. On fait le constat qu’on a envie d’aller dans ce sens : il y a Jean-Paul Antoine, un photographe, qui s’est installé dans une ferme autogérée, que je rencontre dans les bals folk, Jacques Daumas, éducateur en rupture de ban, qui est de Vogué, et fait partie de l’aventure de la Bouche Rouge, un journal très militant, Jean François Terney, croisé à la fac. On s’installe dans une ferme en ruine, celle de mes parents en l’occurrence. On réussit à dégotter un stage sur le financement d’entreprise en milieu rural. Deux d’entre nous sont rémunérés, on partage à quatre. Moi, de mon côté, je fais pion pendant deux ou trois ans dans les collèges du coin, je commence une formation pour devenir guide de moyenne montagne. Pour pouvoir rester au pays et aussi un peu pour rassurer mes parents. Comme on ne dépense pas grand chose – les repas sont chiches ! -, ça permet de mettre de l’argent de côté pour faire un autre film. J’ai déjà un projet dans le pays basque. Parallèlement, autour du cinéma itinérant, on participe au développement de tout un réseau : près de huit cent villages sont concernés en France. C’est d’une incroyable richesse pour assurer la diffusion de films. Cela restera vrai jusqu’en 1984 où l’arrivée de canal+ sera fatale au réseau. Parallèlement ce seront les télés de plus en plus nombreuses qui vont financer le film documentaire et qui le diffuseront évidemment par leurs propres réseaux.
En même temps, on participe à la création d’une salle de cinéma à Aubenas. Il y a là Jacques Daumas, Yves Méjean, Simone et Jean Haffner. A Aubenas, on participe à la construction de deux salles de projection, dans un appartement qu’on démolit de nos mains. Ca s’appellera le Navire et il existe encore d’ailleurs. Mais c’est devenu un multiplex !
Premiers festivals, découverte du documentaire…
En 1978, on organise une première édition du festival de Pays et région où Yves Billom vient présenter un film sur l’Amazonie. Qui s’inscrit dans le sillage de la démarche de Jean Rouch, entre le documentaire et l’anthropologie. On cherche des sous à Paris. Alors qu’on est plutôt contre le centralisme parisien. D’ailleurs, on monte le festival pour mettre en évidence le cinéma tel qu’il se fait en région, avec des gens qui filment ailleurs qu’à Paris, des luttes régionales…Ce sera une constante d’ailleurs dans toute l’histoire du doc à Lussas, les sous se trouvent souvent là haut, à Paris et le savoir faire est ici, en Ardèche. Et d’abord justement dans l’organisation des rencontres et festivals.
C’est au cours de ce premier festival que je découvre vraiment la puissance du documentaire. C’est un peu diffus au début évidemment mais je vois là une occasion de pouvoir s’exprimer sans trop de moyens, dans des conditions matérielles difficiles et surtout en restant chez moi. C’est en regardant le travail de Yves Billon sur l’Amazonie que je me rends compte qu’on doit être capable ici de faire la même chose. On se dit que ce cinéma est à notre portée. Une sorte de cinéma ethnographique. On n’avait pas encore d’exemple autour de nous, autre que l’existence de certains films, comme celui sur Woodstock, que je découvre en 74 et prend une gifle monumentale : on peut donc réaliser des films sans dépenser des fortunes, c’est donc ce genre de films qu’on doit faire alors et c’est dans cet esprit qu’on réalise un dossier de demande de financement auprès du FIC (fond d’intervention culturel du ministère de la culture : NDLR). Notre premier dossier !
On crée donc Ardèche image en 1979 et on reçoit effectivement une aide du FIC pour s’équiper en caméra, table de montage et mixage…Ce sera mes premières démarches au ministère de la culture. Il y en aura bien d’autres…
Cinema paradiso

La même année, je tombe sur une annonce dans les Cahiers du Cinéma où il est question d’accueillir, pendant trois mois, un stagiaire qui participerait au tournage d’une fiction. Ca se passe à Cadaquès. J’y vais et découvre très vite que c’est une arnaque, qu’il n’y a pas de techniciens sur place et que, du coup, on est bien obligé de se débrouiller et d’apprendre les uns des autres. C’est donc ce qu’on fait et quand on commence à tourner en rond, qu’on a appris ce qu’il y avait à apprendre, au bout de huit jours (c’est vrai que c’est assez rapide, se marre notre hôte : NDLR), on se tire en Ardèche. Tout en piquant un peu de pellicule. Avec quatre autres, on se retrouve dans la grange de la maison familiale. Il y a Bertrand Boisson, Pablo Luisoni, Gianné Quini et tout un groupe du coin. On décide d’écrire pendant dix jours un projet de court métrage. Pendant le tournage, qui durera dix jours, le principe c’est qu’on touche donc un peu à tous les postes, le cadre, le son, l’éclairage, la direction d’acteurs… Le film s’intitule « La source de Pramaillé ». On y a beaucoup appris et on décide d’en faire un autre. Qui sera la version courte d’un scénario que j’ai déjà écrit autour de la mort du pays d’ici… Une histoire autour d’un chômeur, une mémé et d’un chien… On lance une souscription et on pré-vend prés de neuf cent billets ! Le tournage dure vingt et un jours, en Juillet 1979. je crois qu’on peut dire que j’y ai un rôle moteur : je suis le seul à en écrire le scénario, qui en trouve le titre : « le voyageur de l’embellie », qui m’occupe de la logistique. Et puis ce sont des conditions quasiment professionnelles cette fois-ci : vingt cinq personnes à faire bouffer chaque jour, dans la grange de la ferme familiale, on récupère ce qu’on peut un peu partout, chez les copains maraîchers, les marchés du pays… La mémé est jouée par une sociétaire de la comédie française qui s’avérera d’ailleurs assez catastrophique dans le rôle, trop décalée… C’est une sorte de fiction documentée on dirait maintenant…
Chercheur d’or…
On commence le montage dans la grange de la maison familiale. Matériellement, c’est vraiment du camping, des matelas au sol, un réchaud à gaz, on abat vite quelques cloisons pour agrandir l’espace. Mais comme le toit menace de s’écrouler, il faut bien qu’on le répare un peu. Et en faisant les travaux, on découvre un véritable trésor, planqué sous une poutre : une quarantaine de Louis d’or. Une somme d’argent rondelette. On donne 50 % à mes parents, les propriétaires. Avec le reste de l’argent, qu’on partage à deux, je décide de faire un mini tour du monde. Qui se transformera en une virée de trois mois à Java et Bornéo. Au retour, je finis le montage, laissé en l’état.
Ce sera la dernière expérience collective de notre petite bande. Bertrand meurt subitement. A l’enterrement, à Rouen, on lit un mot qu’il a laissé : « Continuez le cinéma, ce sera comme me prolonger ».

En 1983, on tourne enfin le film sur le pays basque et surtout sur les clandestins de l’ETA militaire. C’est assez épique. On part avec Marie Odile dans une vieille ami 8 qui finira par tomber en panne, au milieu des Pyrénées. On est reçu par un copain qui nous offre son canapé pour dormir et nous fait rencontrer des gens de la branche militaire de l’ETA. On y va cagoulé, trimballé à droite et à gauche, on y est reçu par des types tout aussi cagoulés, et armés, qui nous débite leur propagande. Pas très intéressant évidemment. Du coup, on se concentre plutôt sur les histoires des bergers qu’on croise au hasard de nos pérégrinations. Nous, ce qu’on veut vraiment réaliser cette fois, c’est un vrai documentaire.
Il faut dire qu’au même moment, le monde de l’image connaît une véritable révolution technologique, on passe de l’hertzien au câble, la vidéo arrive, tout est donc moins cher, et autour de cet univers, les télés privées se mettent à pulluler et à mettre de l’argent. Des boites de production se créent partout. Dont certaines financent le cinéma politique indépendant. Tout cet écosystème a besoin de gens qui savent faire du documentaire. Je prends le wagon en marche. Je travaille notamment pour les carnets d’aventure sur France 2 et devient salarié de la structure Ardèche Images Production. On vit des films d’aventure ou animaliers coproduits par les télévisions. On ne touche pas des fortunes, on vit de droits d’auteur principalement et les diffuseurs nous laissent bien peu d’argent au final.

Salle SCAM
Ca devient vite alimentaire, ce truc là mais on apprend à faire le métier. Quant à moi, je persiste à mettre à un autre niveau l’ambition artistique. Jusqu’à ce que je rencontre Thierry Garel qui, depuis Arte, tire vers le haut l’activité documentaire. On est en 1987. Non seulement, il paye très bien et c’est aussi un véritable troisième œil sur la production et sur ce qui se fait en matière documentaire.
La bande à Lumière…
C’est à ce moment là, dans cet espèce d’age d’or de la production documentaire, qui va durer une quinzaine d’années, que je rencontre les gens qui vont constituer la Bande à Lumière. Une petite cinquantaine de personnes qui comptent dans ce petit monde : on y trouve des gens comme Yves Billon, Agnés Guérin, Jean-Michel Carré, Richard Coppens, Yves Jeannot, Barbet Schroeder… C’est Yves qui m’en parle le premier, de ces réunions. Le prétexte à la rencontre, qui se tient à Paris, est la préparation d’une réforme de l’audiovisuel, par Jack Lang, dans laquelle le documentaire est tout simplement oublié. On décide donc de créer une association et de se rencontrer régulièrement pour faire pression sur le CNC (centre national du cinéma : NDLR) et pour créer un fonds de soutien au documentaire.
La bande est aussi un lieu de conflits et de chapelles où, en gros, deux tendances s’affrontent : d’un côté les gens qui veulent créer un véritable marché du doc, une économie en bonne et due forme, soutenue par les télévisions et donc devoir au final répondre à une demande du grand public, adossée à des festivals européens, grand format ; de l’autre ceux qui veulent amener de la pensée dans le doc, élargir le champ de la culture du documentaire, faire des documentaires qui reflètent une vision du monde, donc un regard d’auteur. C’est un point de césure fondamental : certains appellent ça du nombrilisme, de l’auteurisme comme ils disent, comme une insulte. Moi, je me situe d’emblée dans la deuxième mouvance évidemment, dans le sillage de Thierry Garel. La première tendance, on les retrouve dans de grosses animations comme la Biennale de Lyon puis le Sunny Side of the doc à Marseille devenu aujourd’hui le FID. Quant au Sunny Side, il se tient désormais à La Rochelle…
Pour nous, avec Yves Billon, Agnés Guerin, Jean Michel Carré, Gilles Dinematin, le cinéma documentaire, c’est d’abord de la pensée. Et donc le reflet d’une vision portée par quelqu’un. On est un peu à part pour cette raison. Il faut savoir que, longtemps, les gens du sunny side ne viennent pas à Lussas par exemple. Nous, on est un groupe, on voit les films des uns et des autres et il y a une communauté d’esprit. C’est là que prend forme l’idée de proposer un état des lieux de ce genre de documentaire. Qu’on conçoit comme une sorte d’université d’été du doc. Sans compétition. Emerge donc un jour, on est en 1989, l’idée de proposer des Etats Généraux du documentaire. Sous forme de cahiers de doléances évidemment. Après pourquoi le faire à Lussas ? Et bien, parce que je suppose qu’on a là un savoir faire qui est déjà constitué. Qui a une histoire. On y est à côté du monde sans en être totalement à l’écart, on peut le penser tranquillement. C’est pour ça, qu’aux Etats Généraux, il y a toujours visionnage de films bien sûr et toujours des espaces prévus pour en discuter, des tables rondes, des journées de colloques thématiques, le cinéma dans ses formes documentaires est résolument du côté de la pensée. On veut réfléchir à ce qu’on fait : comment on filme le front national par exemple… Comment représenter la prison, l’enfermement ? Etc etc…

Réverbères...
Comment je deviens producteur ?
Il faut que je gagne ma vie ! Mes films personnels rapportent peu. Et en plus, je tombe malade. Une saloperie que je croise lors d’un tournage en Algérie. Depuis 1983, c’est la télé et le CNC qui finance les films ; il y a des moyens conséquents. Je crée donc, avec Marie Odile, Ardèche Image Production et produit en premier le film sur le pays basque, dont j’ai financé le tournage (qui a coûté autour de 5000 euros) grâce au pionicat et que l’on mixe au musée de l’homme, par l’intermédiaire de Jean Rouch. La pompe s’amorce ainsi, on cherche en permanence des financements pour faire des films et pouvoir salarier quelqu’un pour assurer le suivi des dossiers, la partie technique de la production. On a de la conviction et une part d’innocence aussi sans doute. Un bon producteur, c’est de toute façon toujours l’association de trois compétences : il doit savoir repérer un désir fort chez celui qui veut faire le film, parce que le chemin est souvent long de l’idée à sa réalisation, deux ou trois années, avoir une capacité à accompagner et à y croire et enfin une capacité à trouver les moyens et financements. C’est tout ça, un producteur. Pour faire un documentaire dans de bonnes conditions maintenant, c’est au minimum 100 à 150 000 euros, au moins huit semaines de montage et deux semaines de mixage étalonnage.

Et on ne parle pas du tournage qui peut varier selon tout un tas de paramètres. Sachant que 90 % du film doit être financé avant le tournage, il vaut donc mieux avoir un producteur qui y croit. Sachant encore que le financement est devenu plus institutionnel qu’avant, les télés s’étant nettement désengagées. Ou alors soutiennent des trucs sans beaucoup d’intérêt. Le CNC finance toujours près de 2000 heures par an mais 850 heures sont achetées par les télés et c’est le plus souvent des trucs animaliers pour passer en fin de nuit, selon le cahier des charges qui les oblige, il reste donc 200 heures pour le documentaire de création. Donc on cherche de l’argent en permanence.
Le festival comme fil rouge….
Après le tournage du film sur la tradition orale en Cevennes en 78 , je réussis à convaincre la bande des amis du foyer de jeunes du canton de créer un festival qui s’appellera Cinéma de Pays et région. On crée Le blayou pour ça et en gros, on veut y montrer des films politiques et surtout produits et réalisés en région. C’est ainsi que, lors de la première édition, viennent René Alliot, cinéaste important des années soixante-dix, qui propose une fiction sur les camisards, mais aussi Daniel Guérin et son film Lou Païs. Comme on est un peu SDF sur la commune, on n’a pas de lieu de projection par exemple, mes parents prêtent un hangar à la sortie du village où ils entreposent du matériel agricole. Viennent quand même au rendez-vous quelques quatre cent personnes ( on en refuse autant !) un jour d’avril. On les accueille comme on peut, avec les moyens du bord, au milieu des caisses de poires, de draps suspendus pour les projections, des gradins faits avec des rangées de parpaings. Il n’y a jamais eu de festival avant dans le coin et le Dauphiné ( journal local : NDLR) nous fait une bonne pub. Il fait vraiment froid par contre ce soir-là et le garagiste du village nous prête un canon à chauffage, ça pue franchement le diesel et il fait un tel vacarme que l’on est obligé de l’arrêter dés que la séance démarre. On est une bande d’une quarantaine de personnes, des copains du foyer des jeunes, objecteurs de conscience, des fanas de folk rencontrés à droite, à gauche, à force de bals et de concerts… On mange souvent à la maison des Barbe. C’est un peu punk. Alternatif on dirait maintenant. Au final, ce sont des bons moments vraiment sympas à vivre…. Qui durent quand même sept années.
Et en 1986, on est obligé de constater un certain essoufflement dans Ardèche Images et on imagine alors un autre festival populaire autour du cheval. Je viens de faire un film sur le sujet où j’ai suivi l’itinéraire de trois chevaux Merens autour d’une partie du bassin méditerranéen. Qui m’a donné accès à ce monde là. Et l’idée est sans doute née comme ça.
Les festivals, c’est formidable, parce que ça permet de fédérer des gens et des énergies autour d’une vision commune et de défendre ce qui tient à cœur, c’est un marqueur culturel du temps présent. S’impose plus ou moins consciemment l’idée d’accorder toujours une grande importance aux gens qui font le pays, de mêler les univers, de s’intéresser aux sans noms et aux invisibles. Ici, en l’occurrence, le monde du cheval qui évidemment parle au monde rural et celui du documentaire. Simone Haffner a l’idée d’organiser, durant le festival, un marathon d’un genre un peu particulier. Qui consiste à créer un scénario de court métrage en trois jours et trois nuits. On arrive à attraper des subventions pour mener le projet : « c’est l’idée la plus folle de l’année » nous dit-on à Paris. Bref, ça fonctionne. On sélectionne quinze personnes. Le public peut voir les projets avancer au fur et à mesure. Les candidats sont dans un chapiteau ou à la salle des fêtes, on leur apporte des croissants et des chocolats, ils tapent à la machine, chacun la sienne. Le festival marche très bien. L’aventure dure trois ans.
la maison Barbe. Rue principale Lussas.
Et, à un moment, on peut s’appuyer sur le vécu accumulé là dedans pour se lancer dans l’aventure des Etats Généraux. Qui dure depuis. Je crois qu’on peut dire que c’est devenu un rendez vous important dans le monde du documentaire français et international. En 1989, avec la bande à Lumière, on se retrouve à présenter un ensemble de projets d’actions autour du documentaire dont celui des États généraux, avec l’idée de présenter des cahiers de doléances pour la sauvegarde du documentaire tel qu’on l’entend, nous. Notre interlocuteur au CNC décide alors de nous accorder une aide de 15000 euros qui sera déterminante. Cela permet de déclencher d’autres soutiens et de nous crédibiliser auprès des professionnels et ainsi de pouvoir payer les déplacements des réalisateurs invités, la bouffe des bénévoles, etc etc…
On imagine une organisation qui doit coûter près de 40000 euros. En 1991, j’en deviens le salarié et je débauche Pascale Paulat, qui était alors secrétaire de mairie à St Laurent sous Coiron et va devenir la gestionnaire de la manifestation. La région et le département suivront durant la décennie suivante. La mairie fournit du temps de ses ouvriers d’entretien, l’accès à la salle polyvalente et la salle de cinéma. La maison Barbe prend en charge pas mal de l’intendance (le grand garage pour les spectacles notamment mais aussi souvent la bouffe ou l’hébergement des invités, des bénévoles). On sollicite les hôtels de la région, mais aussi les habitants.
Dès le départ, le festival dure la semaine, on invite autour d’une centaine de personnes, la régie nous est prêtée par la FOL (fédération des œuvres laïques : NDLR)… Maintenant, trente trois ans plus tard, le festival permet de salarier toute l’année deux ETP, celui de Pascale Paulat et de Christophe Postic, plus une vingtaine d’ emplois d’intermittents en saisonnier et regroupe pendant une semaine au milieu du mois d’Août, près de 120 bénévoles pour un budget d’environ 420 000 euros. difficilement en équilibre d’ailleurs. Le public répond présent, autour des vingt deux milles entrées chaque année.
De mon côté, je tire ma révérence en 2003, en démissionnant de mon poste de délégué général. Dix ans, c’est le maximum selon moi pour passer la main et j’ai largement dépassé le délai. Et puis 2003, c’est l’année des grèves des intermittents où quelques uns prennent le risque de foutre en l’air le travail de tant d’années, l’investissement de tant de gens. Est ce qu’ils ont conscience du tout dans lequel ils s’inscrivent ? Je n’en suis pas si sûr. C’est bien sûr l’éternelle question des pouvoirs et contre-pouvoirs, mais leur lutte de cette année là peut aussi tuer beaucoup d’initiatives dans le monde culturel et je ne sais pas si tout le monde en a réellement conscience. Bref, je me pose pas mal de questions. Le divorce télévisions / films documentaires est acté. Le paysage audiovisuel documentaire, comme toute aventure humaine, doit se réinventer. J’ai la conviction qu’Il faut imaginer d’autres modes de production et de diffusion avec le numérique qui arrive.
En attendant, une chose est sûre : malgré le « lâchage » de la TV, inlassablement, il ne faut pas arrêter d’interroger le sens des images et la fonction des représentations documentaires. Il faut continuer de filmer et montrer les films. Heureusement, on peut le faire pour moins cher : la technique évolue et coûte moins. Et puis, en France, les aides institutionnelles restent conséquentes. Il y a un éco-système qui reste propice… Mais les documentaires ont de plus en plus un public limité.
Résidence d’artistes et masters universitaires : le modèle lussassien à la conquête du monde..
Après 2003, on va développer à Lussas deux projets distincts mais complémentaires : l’école du documentaire et la structure doc/Monde. C’est ce qui va occuper pas mal de mon temps durant au moins dix années.
Dés le milieu des années 90, toujours dans l’optique de consolider le démarche créatrice et donc l’économie autour, avec l’idée de tenir toute la filière création /production/diffusion, on commence à organiser des résidences d’artistes à Lussas. La première s’y tient en 1996. L’idée des résidences, à Lussas comme partout, est de faciliter l’apparition et la concrétisation d’un désir de film. Pouvoir écrire au calme, à plusieurs pour l’émulation. Il s’agit aussi de pouvoir voir des films. Et de s’en inspirer. Il y a donc trois temps : trois semaines de réflexion et d’écriture, le temps des repérages et celui de la concrétisation du scénario. Trois semaines à nouveau. Un référent-professionnel pour six personnes maximum qui peuvent être rémunérées par l’AFDAS ( opérateur de compétences des secteurs culturels : NDLR) avec qui on passe un accord. Il s’agit de travailler des projets de films mais aussi de pouvoir assurer les rencontres des producteurs et des projets. Le coût de la formation tourne autour des 3500 euros. A Lussas, les étudiants et stagiaires sont logés chez l’habitant ou dans des gîtes. On a un local en face de l’église.
Africa doc : la conquête du monde
"Après 2003, on va développer à Lussas deux projets distincts mais complémentaires : l'école du documentaire et doc/monde"
Parallèlement, dés 1999, je fais un dossier que je présente à l’université de Grenoble pour ouvrir un Master de réalisation documentaire à Lussas. Parce que, pour moi, c’est toujours la même chose, les deux doivent aller de pair : il faut toujours parvenir à associer l’idée et les moyens pour la réaliser. A partir de là, comme il n’est pas question pour nous de faire une énième école d’art pour gosses de riches à 15 000 euros par an, il faut donc solliciter des financements publics et institutionnels. Côté institutionnel, il y a une opportunité à saisir. A l’invitation du CNC, je participe à une commission, en son sein, dont l’objet est de proposer la mise en place d’ateliers de formations à l’audiovisuel. Il y a une volonté de créer des centres régionaux d’aide au documentaire. Tout semble concourir pour que ce soit nous qui en bénéficions. Mais, pour des raisons de poids politique, au dernier moment, c’est Annecy qui sera choisi pour la région. Du coup, le directeur de l’audiovisuel du CNC, quand même un peu embêté que ce ne soit pas Lussas qui ait été choisi, accepte de financer une partie du budget de fonctionnement du Master. Il fait une exception en quelque sorte. Pour nous. Cela représente quand même une aide de 20 000 euros d’argent public et surtout une reconnaissance de l’Etat . Après, c’est évidemment plus facile d’aller voir la région. On est adoubé en quelque sorte. Il se trouve aussi que la responsable de l’enseignement Universitaire pour la région Rhônes-Alpes est une ancienne trotskiste qui aime bien le projet de Lussas. Et qui accepte de financer une partie du Master. A hauteur de 30 000 euros. Le provisoire durera jusqu’à l’arrivée de Laurent Wauquiez à la région. Dés l’année 2000, ceci nous permet de lancer le master et dés 2002, de nommer et rémunérer Chantal Steinberg comme directrice ainsi qu’une assistante pour assurer la continuité des actions éducatives. Depuis, on y organise chaque année des cours en réalisation (12 étudiants) d’abord et puis, à partir de 2007, en production ( pour 6 étudiants), mais aussi de la formation continue, des rencontres professionnelles destinées à soutenir la création de premiers films et les résidences d’écriture au rythme de deux sessions par an ».

C’est ainsi que le vieux rêve de Jean Marie prend, ici aussi, progressivement forme : le monde entier peut se retrouver dans ces formations. Qui sont pionnières dans le domaine de la création documentaire et contribuent largement à entretenir un terreau propice à la création autour de celle ci : « Assez vite, on se dit pourquoi ne pas organiser la même chose aussi partout dans le monde. Créer ce qui pourrait devenir une sorte d’internationale du documentaire. A partir du modèle de Lussas. Que les gens puissent avoir les moyens de réfléchir et de créer du documentaire à Lussas comme partout ailleurs. Pour ça, comme toujours, il faut des financements et des partenaires. On en trouve comme on peut. On a un bon réseau quand même. Il se trouve qu’à l’époque, l’un des responsable des relations internationales à la région est un écologiste : Eric Arnoux que j’ai filmé quinze ans plus tôt avec ses chèvres. C’est le genre de rencontre qui facilite les choses bien sûr. Il y a de la confiance. Il me présente au président de la commission des relations internationales qui est convaincu de l’intérêt du projet. La région va donc être un partenaire central.
En 2001, on crée la structure Africadoc et, en 2002, on parvient à organiser, avec quelques 30 000 euros, deux résidences à Gorée, au Sénégal. On suit ce qui marche déjà, le même chemin tracé à Lussas à Saint Louis du Sénégal où, invité par le Centre Culturel Français, je découvre des possibilités pour former sur place une génération de documentaristes. On constate pendant les résidences qu’on organise qu’il y a un véritable engouement de nos collègues africains. On crée donc Africadoc en 2001 et germe l’idée de mettre en place un master pour institutionnaliser et pérenniser l’élan suscité là bas aussi. L’ambassade au Sénégal est prête à mettre quelques milliers d’euros dans le projet. L’enjeu est de former pendant huit ans dix réalisateurs par an. Et de leur faire rencontrer des producteurs. L’objectif est double : former des auteurs et permettre que leurs films soient vus, par des producteurs d’abord, le public ensuite. On met en place des rencontres de production annuelle. On imagine un festival, sur le modèle de Lussas, qui s’appelle le festival du film documentaire africain à Saint Louis. Au même endroit, on s’emploie en 2007 à créer un master de réalisation de documentaire de création. Après, il y aura Madagascar où on initie le master de Tamatave pour une dizaine de stagiaires par promotion. Novossibirsk…
Pour la Russie, invité par Hélène Châtelain, qui est un peu l’égérie, d’origine russe, de Chris Marker, on va d’abord montrer, dans un festival à Novossibirsk, des films français issus des Etats Généraux, on reçoit à Lussas sa directrice et, dans un second temps, on propose un projet de résidences en relation avec un contact de l’ambassade de Moscou. Il y aura encore Irkoutsk, La Guyane, la Géorgie, le Caucase, la Nouvelle Calédonie… Bernard Soulages, vice président de la région, devient le président de Doc/Monde, créée en 2012. On essaie de garder la même démarche partout : il s’agit de lier l’écriture avec la production/diffusion. Tenir toute la chaîne. Une coopération internationale commence à se tisser sur ces principes. On décline le principe partout ainsi que l’appellation : eurasiadoc, asiadoc, amazonia doc…
Du coup Astérix peut être……Soit ! Mais il y a aussi du Tinitin, chez l’homme du coiron ? Non ? Nous on trouve…
Risquer un regard, révéler des visages….
Vers 1994, on concrétise un autre pendant à nos activités. Important à nos yeux. Fondamentale même. On veut créer les conditions d’une conservation des documentaires créés de par le monde et parfois peu ou pas vu et on met en place aussi les fondations d’une maison du documentaire, sorte de bibliothèque générale du doc. Parce qu’il faut garder tous les films, constituer une mémoire. Ca fonctionne sur le modèle de la coopérative : je laisse un film et j’ai accès aux autres. Ca reste donc largement entre professionnels. On y trouve aussi tous les films montrés aux Etats Généraux toutes les années. 20 000 films à ce jour. On est maintenant associé à La BNF. Dans notre volonté d’internationalisation comme dans celle d’ouvrir à chacun la documentation, mémoire du doc, il y a la question du débouché des œuvres – il faut que les films soient vus, puissent être visionnés par le plus grand nombre, mais il y aussi la question de l’universalisme. C’est politique au bout du compte... Bien sûr… » . L’entreprise se présente au public comme l’expression d’une volonté de « sortir de l’entre soi, de multiplier les regards et amener de la subtilité sur la représentation de la réalité ». Parce que « le cinéma documentaire, celui qui risque un regard, une forme, révèle le visage des inconnus qui peuplent le monde… Et ainsi nous renseigne sur le nôtre… ». Voilà comment l’entreprise se propose aux curieux, se présente au public.
Toujours dans le même esprit de pérenniser les parcours et donc l’économie du doc et de ses artisans, se créent encore des structures comme les toiles du doc, le portail film-documentaire.fr, docnet films pour élargir encore et toujours les possibilités de visionnage et conserver les œuvres. On retrouve ainsi les marques d’une constante primordiale dans l’histoire du village documentaire : tenir toute la chaîne autour des films et leur permettre de s’inscrire dans le temps.
L’expérience Tenk en l’imaginaïre
« Produire des idées, je crois pouvoir dire, avec le temps, que c’est un peu mon talent » nous dit Jean Marie un jour. On le croit volontiers. Parce que c’est toujours ainsi, qu’un jour, naît l’idée de Tenk dans un coin de son cerveau toujours en ébullition. C’est sans doute épuisant pour l’entourage, mais c’est ainsi.
Pierre Mathéeus nous le confirme à sa façon un jour du festival de ce mois d’Aout caniculaire, à l’ombre et devant des bières fraîches grandement appréciées de chaque côté de la table : « Travailler avec Jean Marie, c’est à la fois stimulant et épuisant. A un moment, j’ai été obligé de lui demander de se limiter à une idée par jour pour que je puisse au moins commencer à imaginer mettre en œuvre le début de la réalisation.». Bien des protagonistes de l’aventure Tenk dans le film de Claire Simon ne disent pas autre chose. Mais c’est ainsi que, là encore, notre hussard du doc reste un homme d’obsession. Et s’il y en a une qu’on retrouve tout au long du compagnonnage du bonhomme avec la forme documentaire, c’est bien celle de trouver des moyens de diffusion qui soit à même de soutenir la création et donc de défendre les auteurs et leurs regards.
Parce qu’il faut bien constater, au début du nouveau millénaire, que les télés se désengagent de plus en plus de la production (et d’abord de celle qui est un peu plus exigeante) et donc de la diffusion de la forme documentaire. Il pense un moment à une bibliothèque d’échange de DVD par correspondance. A une télé de villages. Mais la technologie évolue alors si vite que les projets sont souvent déjà obsolètes avant même de pouvoir être pensés dans toutes leurs conséquences.
Qu’à cela ne tienne. Ca continue de s’agiter dans les neurones du griot de Lussas. Parce que « produire des idées… ». Quel matin se dit-il alors que ce qui pourrait être vraiment bien, ce serait carrément de créer une TV ? En bonne et due forme. Une plateforme de diffusion par abonnement entièrement consacrée au documentaire tel qu’on le conçoit du côté de Lussas ? Ainsi donc, la boucle serait bouclée comme on dit. La totalité de la chaîne conception – fabrication – financement – diffusion de films pourrait être tenue des deux mains au même endroit. Ou comment se rendre maître de l’espace temps autour de la production d’images, des réverbères plantées le long de nos chemins. Bon sang, mais c’est bien sûr. : créons une sorte de netflix du doc comme le dira un jour une présentatrice de France Inter à un Jean Marie un brin médusé de l’association d’idées… Y’a plus qu’a donc…
Et Tenk fut…
Euh presque ! Presque… Parce que d’abord une TV, ça prend de la place bon sang. On peut pas rester longtemps dans une des maisons du village, on en occupe déjà tant. D’ailleurs il n’y en a plus. Non il faudrait un lieu. Un lieu à nous. Surtout avec une télé. Et puis, il faut financer bien sûr. Recruter des compétences. Ce sera Pierre. Laure, Diane…Beaucoup d’autres suivront. Presque une vingtaine aujourd’hui pour la seule Tenk. Pour un budget de 500000 euros. Une dizaine de milliers d’abonnés. Mais ça c’est aujourd’hui. Au mitan de la deuxième décennie du nouveau millénaire, au moment même où Paris est touché de plein fouet par les ténèbres du terrorisme, rien de tout cela n’existe encore, du côté des éclaireurs. A part dans la tête de quelques uns dans l’entourage de Jean Marie. Mais on installe quand même les embases pour tous les « réverbères » du monde à venir. Tout est donc à faire. Il existe sur le sujet un documentaire (évidemment !), qu’on ne peut que vous recommander, qui se nomme « Le fils de l’épicière, le maire, le village… et le monde » réalisé par Claire Simon et qui relate par le menu la genèse concomitante de la plate-forme et de son écrin, l’imaginaïre. Il se trouve facilement sur le net (et sur tenk re-évidemment) sous sa forme de séries de dix épisodes ou de film et nous offre un regard particulier (évidemment ter !) vraiment intéressant sur cette aventure collective. Dans une saisissante mise en parallèle avec les cultivateurs qui s’échinent contre vents et marées à faire pousser fruits et légumes dans la contrée.
On vous recommande d’ailleurs vraiment aussi un visionnage du site Tenk dans son ensemble. Et de la programmation proposée et renouvelée en permanence : dépaysement, étonnement, surprise garantis. Chaque semaine. Chaque mois. Des nouvelles du monde. Ca arrive de partout. Sous toutes les formes. Pour six euros par mois, ( il y a une formule découverte à un euros sans engagement) c’est pas cher payé de notre point de vue. Parce qu’au fond, qui pourrait estimer au plus juste ce qui se joue quotidiennement là bas, dans les couloirs de l’imaginaïre, dans les rétines des binômes de sélectionneurs de films qui finissent par arriver un jour sur nos écrans et viennent titiller le notre, d’imaginaire ? Bon, vous l’aurez compris, nous, on est vraiment convaincu. Mais c’est à vous d’être curieux.
Bande annonce du film de Claire Simon. Où on retrouve Jean Paul, Pierre, Diane, Jean Marie, la ministre, les cerises....
Dans le film de Claire Simon, beaucoup est dit de la construction de la plate-forme et du bâtiment l’accueillant. De l’élan aux doutes. De l’idée à la concrétisation un jour de 2016. La recherche d’argent. Ce que ça implique ( alors, bon sang, on le prend l’argent de la fondation de François Hollande ? Il y a Total dedans : qu’est ce qu’on fait ? Faut bien payer les salaires etc etc…). Tant de moments décrits par le menu, de réunions, de disputes, de nuits écourtées, de voyages à Paris, tant de portes, de journalistes, de ministres reçus (mais oui, madame la ministre aime les marrons glacés !), de départs, d’arrivées, de visites, de maquettes et de plans, tant de cheveux qui blanchissent chez Jean Paul Roux, président de la communauté de communes du Berg et du Coiron, tant de questions, de conseils, de subventions qui n’arrivent pas, d’autres qu’on fait traîner, de mécènes à convaincre, de conseils d’administration (tenk est une SCIC qui compte une bonne centaine de sociétaires), tant d’énergie, de découragements… C’est pas une petite affaire bon sang ! Bien sûr, on n’y connaît rien au départ. Alors, on fait venir des spécialistes de tout poil, des communicants, des experts en informatique, on recrute les compétences manquantes quand c’est nécessaire. Bref, faut s’improviser chef d’entreprise. C’est sans doute là, de notre point de vue, que le film de Claire Simon prend toute sa force : dans la narration de cette mue obligée de gens chez qui rien ne prédispose à l’exercice de ce nécessaire « sacerdoce ».
Arrive ainsi vite le temps où il faut donc penser nécessairement rentabilité et gérer une équipe qui dépasse vite la quinzaine de personnes. Parce que c’est « pas du tout pareil de gérer des équipes de cinq personnes et des groupes trois fois plus nombreux » ? nous dit Jean Marie un jour. Et comment donc on en vient à surveiller fébrilement les chiffres d’abonnement, comment on passe le millier sans coup férir, puis les cinq mille bon sang, puis… Et comment on fait pour financer des postes toujours plus nombreux et toujours plus nécessaires ? Et comment on fait comprendre aux indispensables nouveaux venus l’héritage de ce qu’est Lussas ? Comment on maintient la motivation de tous intacte ? Et comment on se fait accepter par la population locale aussi ? Comment on recrute ? Sur quels critères ? Autant de questions que les protagonistes vont être amenés à se poser au fur et à mesure du développement de Tenk. Bien obligé. La contrepartie à toutes ces soirées passées à imaginer, à se faire de la bile, à se frotter au vertige des sommes en jeu, c’est qu’un indiscutable succès se dessine dés les premiers mois au cours desquels les abonnements affluent bien vite, où on trouve des mécènes inattendus qui veulent mettre du sens dans leur placement financier, où on passe des partenariats prometteurs (avec Médiapart notamment, France Culture et beaucoup d’autres). Mais peut être la meilleure récompense, c’est aussi cette scène magnifique où, au milieu de la nuit ardéchoise, quelqu’un devant un écran, un technicien faisant les derniers réglages, voit poindre tout à coup la page d’accueil de la plate forme ( qui sera à jamais la première vision de Tenk) comme s’il venait d’apercevoir une planète oubliée au fond d’un trou noir.
Alors pourquoi Tenk, Jean Marie Barbe ?
La contrepartie surtout, c’est Tenk qui est toujours là, coopérative aux 131 sociétaires, contre vents et marées, à matérialiser un projet constant dans les entreprises lussassiennes autour du documentaire : mettre en place une économie pérenne autour des films d’auteur. Donner à voir et permettre d’entendre toute la complexité des affaires humaines et documenter le monde.
L’imaginaïre, quant à lui, qui n’a même pas jugé bon de remplir tous les canons d’un certain esthétisme architectural contemporain (les avis sont partagés sur le sujet), ne fait pour autant pas tâche dans le paysage lussassien et surtout remplit très bien depuis cinq années maintenant sa vocation initiale qui est d’abord et avant tout de réunir au même endroit l’ensemble des structures et gens intéressés à la vie du documentaire telle qu’on la conçoit du côté du Coiron : on y trouve donc des maisons de production, des studios de mixage, de montage, des espaces pour se documenter, visionner et discuter de quoi ? Et bien de doc pardi ! Tenk donc, ses secrétaires, assistants de production, programmateurs, mixeurs de son et d’image, scénaristes en quête de Graal, étudiants, une cafeteria et cuisine commune, des salles de projection, des bureaux à louer… Tout un monde quoi ! Il y a même une grande table sur une terrasse, juste dans le prolongement de l’immense cuisine devant laquelle on se surprend à imaginer se tenir là des banquets de gaulois rigolards et il ne faudrait pas nous pousser beaucoup pour finir de nous persuader qu’il y a définitivement quelque chose du petit moustachu de fiction dans la personnalité du dénommé Barbe ancré en son village depuis le milieu des années 70 : sans doute une même farouche volonté de résistance, une commune énergie mais aussi une curiosité pour le lointain, un même culte pour l’amitié. Des choses de ce genre… « C’est vrai que j’ai souvent été meneur » nous raconte t-il comme quelqu’un qui n’a jamais vraiment pris la peine d’y réfléchir. Même appétit aussi de vivre des aventures. Parcourir le vaste monde, aller voir l’ailleurs mais s’ancrer en son pays. Et un soir, on se surprend à se demander, en remontant la nationale 102, pour rentrer chez soi, de l’autre côté du mont Mezenc, si Astérix… mais oui finalement : Astérix, c’est pas si mal come métaphore… Mieux que Tintin, à cause du village justement…
On a livré, on y livre encore, bien des combats du côté de Lussas, le duo Barberousse souvent aux avants postes aura tout fait donc pour éloigner les vents mauvais des illusions perdues et des combats perdus parce que jamais menés. Jean Marie dit en quelque part un jour autour de la question du sort des intermittents et de ceux qui font vivre l’art au quotidien dans nos contrées – on est aux alentours de 2003 – que la situation correspond à un « vide laissé vacant par une génération à qui il a manqué l’esprit d’opposition et de revendication, puis finalement d’esprit critique » et que peut être « sommes nous parvenus au bout de quelque chose, à l’épuisement de ce désengagement, de ce repli, pour sortir d’une forme de résignation ».
Peut on mieux dire un certain état d’esprit ?
l'imaginaïre : dans les murs....
L'imaginaïre encore : bureaux, affiches...tel quel...
« Allumeur de réverbères » donc …
« Eclairer, jour après jour, éclairer, amener à chaque instant le jus dans cette cité de la mémoire et de la représentation pour qu’existe autre chose qu’une impasse glauque, qu’un cul de sac, qu’une voie du réel.». Voilà comment Jean Marie présente le programme des premiers états généraux en 1989. Ils sont inaugurés le lundi 28 Août 1989, par une soirée justement « consacrée aux grands rebelles qui ont détourné des films de commande pour en faire des documentaires à part entière ». Ils ont pour nom, ces grands rebelles auxquels on se rallie dés les premiers instants de l’aventure, Joris Ivens, Franju, Chris Marker ( ce dernier à qui d’ailleurs Jean Marie consacrera avec son ami Arnaud Lambert un film en 2017). Ainsi est fondé d’emblée un patronage à travers une généalogie de la piraterie, qu’on pourrait peut être interpréter comme l’expression à la fois d’une certaine philosophie de tête de lard (l’art ?) en même temps que révélatrice de la pauvreté relative de l’économie autour de la production des œuvres : une « philosophie de la misère » qui ne soit certainement pas une « misère de la philosophie » donc… L’histoire des Etats Généraux et leur place particulière dans le monde du documentaire ne se comprend sans doute pas sans avoir conscience de cette vocation qui est aussi celle du village documentaire en son entier; par suite logique, tout ce qui a été entrepris autour du documentaire à Lussas depuis quatre décennies ne se comprend pas sans avoir en tête cet arrière fond originel d’une certaine rébellion initiale.
Il nous semble que ces deux aspects intrinsèquement liés, la philosophie de l’engagement et de la résistance et une certaine forme de dédain pour les richesses ostentatoires, ce matérialisme tellement contemporain, on les retrouve donc aussi dans la personne même de Jean Marie. Avec constance. De ce point de vue, il n’a pu en effet que contribuer à bâtir, du côté du Coiron, un univers qui lui ressemble forcément par de nombreux traits. Il nous le dit lui même : « Oui, à Lussas, je crois qu’on a su être pauvre et déterminé...Et matérialiser des rêveries… Pour prendre mon parcours personnel, au début, vers la fin des années soixante-dix, j’ai voulu être accompagnateur de moyenne montagne. Puis animateur de centre social. J’ai pris une autre route. Et touché mes premiers salaires en 1992. j’avais presque quarante ans. Entre les deux, j’ai alterné les petits boulots, été pion, produit quelques films. J’ai été souvent hébergé chez mes parents, roulé en vieille 2 CV, en simca 1100. Ma mère m’a beaucoup aidé. Sans elle, et toute la communauté familiale autour, tout aurait été beaucoup plus compliqué. Pendant toute la période du Blayou, c’est du bénévolat total et c’est ma mère qui me fait bouffer. Sur le festival autour du cheval, on est dix et on file 500 balles par personne pour financer. On a pas de subventions, pas de matériel. On est entre la culture et l’agriculture et du coup, on ne touche rien ni de l’un ni de l’autre… D’ailleurs, on arrête parce que ça nous coûte trop cher. Moi, je suis toujours bénévole à 100 %. Toutes les années quatre-vingt, on fonctionne sans aide. Juste sur le désir de montrer du cinéma. Mais on accumule des compétences l’air de rien. Qui nous permettent de développer un autre projet de festival, de se faire les dents dans le cinéma itinérant.
Quand je dis je, c’est toujours un nous…
J’ai toujours fait une dizaine de choses en même temps. Beaucoup bossé. Il faut croire en ses désirs. Et toujours faire à plusieurs. C’est indispensable d’être à plusieurs. C’est le conseil que je donnerais à des jeunes. J’ai rencontré tellement de gens au bout du compte, un jour où l’autre. Croisé tellement de routes. Je crois que si j’ai un talent, c’est celui de savoir fédérer des énergies à un moment donné. Je ne suis pas un gestionnaire, ça m’ennuie très vite. Mais emmener des collectifs, ça j’ai appris… Quand je dis je, c’est toujours un nous en fait. Le doc, c’est la même chose, c’est aussi de la pensée à plusieurs. Il y a en France aujourd’hui quelques dix mille personnes qui font du documentaire. Quelques cinq cent films par an. L’idée toujours est de faire émerger une contre-idée par rapport au flux médiatique, un autre point de vue sur le monde. C’est là que le village documentaire, Tenk, l’imaginaïre et bientôt Cinémas Documentaires (NDLR : le nom du projet de seconde plateforme) s’inscrivent. L’idée demeure de faire vivre une communauté d’esprit autour de gens qui ont « envie de sens ».

Communauté et quête de sens. Ceci nous paraît définir finalement au plus près la trajectoire de Jean Marie tout au long de ses deux premiers tiers. Et par extension tout le village documentaire. Pour finir temporairement (!) ce portrait d’un homme, parce qu’il faut bien conclure, citons le une dernière fois, lui et ceux ( Pascale Paulat, Christophe Postic) qui continuent de faire vivre les Etats Généraux ( parce que « je est un nous », toujours !), citons donc l’éditorial du fascicule de présentation du festival, celui de 2003, le dernier comme directeur de notre homme où il déclare l’état d’urgence devant la question de la rémunération des intermittents du spectacle et du désengagement des télévisions dans la production des documentaires : « Il n’y a pas de conscience politique sans intelligence sensible. Et la culture devrait être cette capacité d’une société à porter l’acte de création (…) la porter, cette trace, jusqu’au regard d’un autre, à qui elle est étrangère, invisible pour le moment. S’il s’agit de préserver un espace pour la création, c’est bien aussi pour imaginer les conditions de la rencontre d’une oeuvre avec un spectateur… L’enjeu étant bien de redécouvrir et réaffirmer en quoi l’art nous implique, nous concerne. Pour se sentir à nouveau concerné… il s’agit.. d’interroger le pouvoir des films au sein de la société des hommes mais penser parallèlement son pouvoir plus intime sur l’individu : le lien de fascination, d’amour, de filiation entre un film et son spectateur. La possibilité d’un film à se faire monde… Tenir donc ensemble ces deux bouts du phénomène de l’image : son origine – le geste et le désir dont elle naît – et son devenir pour un regard et pour une pensée ».
A la lecture de ce « testament » qui marque la fin de son parcours d’ambassadeur officiel des Etats Généraux, en 2003, on ne peut que penser que, derrière ces mots d’adulte qui referment une période de sa vie pour se tourner vers une autre, se profilent encore et toujours un enfant et son émerveillement devant le flot d’images projetées sur un drap tendu à la va vite dans une salle obscure, du côté de Lussas, au mitan des années 60.
Selon toute vraisemblance, Jean Marie est resté cet enfant toute sa vie. Il l’est encore.
Biblio :
1 . Emmanuel Carrère : « D’autres vies que la mienne », Paris, POL, 2009.
2 . JM Barbe : hommage à jean Paul Roux, église de Lussas, 2022.
3 . Les sites internet évidemment : tenk.fr et son blog ; lussasdoc.org ; lussasvillagedocumentaire.org .
4 . Toutes les photos ont été prises avec mon fidèle Canon lors des derniers états généraux ou lors de visites durant les années 2021 et 2022…
Filmographie :
- 1979 : Benleù Ben, la tradition orale en Cévennes, 52 min (co-réalisation avec Jean Jacques Ravaux et Marie Odile Méjean)
- 1980 : Le voyageur de l’embellie, 50 min – fiction (auteur réalisateur)
- 1985 : Cerro Torré, 26 min – documentaire de découverte (auteur – réalisateur)
- 1985 : Trois chevaux Mérens en voyage, 52 min documentaire de découverte (auteur – réalisateur)
- 1986 : Beyrouth, l’argent de la guerre, 52 min, magazine d’information – (auteur réalisateur)
- 1987 : Le Grillon du métro, 26 min – (auteur réalisateur)
- 1989 : Une affaire mouche, la mouche dans l’enquête policière, 26 min – (Arte) (auteur réalisateur)
- 1992 : L’Epicerie de ma mère, immersion dans une petite épicerie de village, 30 min – (Arte) (auteur réalisateur)
- 1994 : Les Moissons de l’utopie, 52 min – (Arte) (co-réalisation avec Yann Lardeau et Yves Billon) (auteur réalisateur)
- 1995 : La Classe de philosophie, suivi d’une classe de terminale en cours de philo sur une année scolaire – (Planète) (co-réalisation avec Bernard Cauvin)
- 1997 : La République des maires, 52 min – (FR3) (auteur réalisateur)
- 1999 : Changement de direction, 52 min – (FR3) (auteur réalisateur)
- 1998 : Le juste Non ! 70 min – (France 2, FR3) (coauteur avec Caroline Bufard)
- 2001 : Les Ouvriers de la terre, 52 et 63 min – (Arte) (auteur réalisateur)
- 2006 : Je prends ta douleur, 46 min – (TLSP) (co-réalisation avec Joëlle Janssen)
- 2008 : Oncle Rithy, 90 min – (Ciné Cinéma)
- 2012–2020 : Mémoires commune, (co-réalisation avec le Groupe des documentaristes de Lussas)
- 2015 : Lumière d’octobre, 70 min (Lyon Capitale) co-réalisation avec le collectif des documentaristes Burkinabés
- Histoires communes, 4 × 50 min auteur réalisateur
- 2015 : Chris Marker Never explain never complain, 148 min (Ciné +) co-réalisation avec Arnaud Lambert